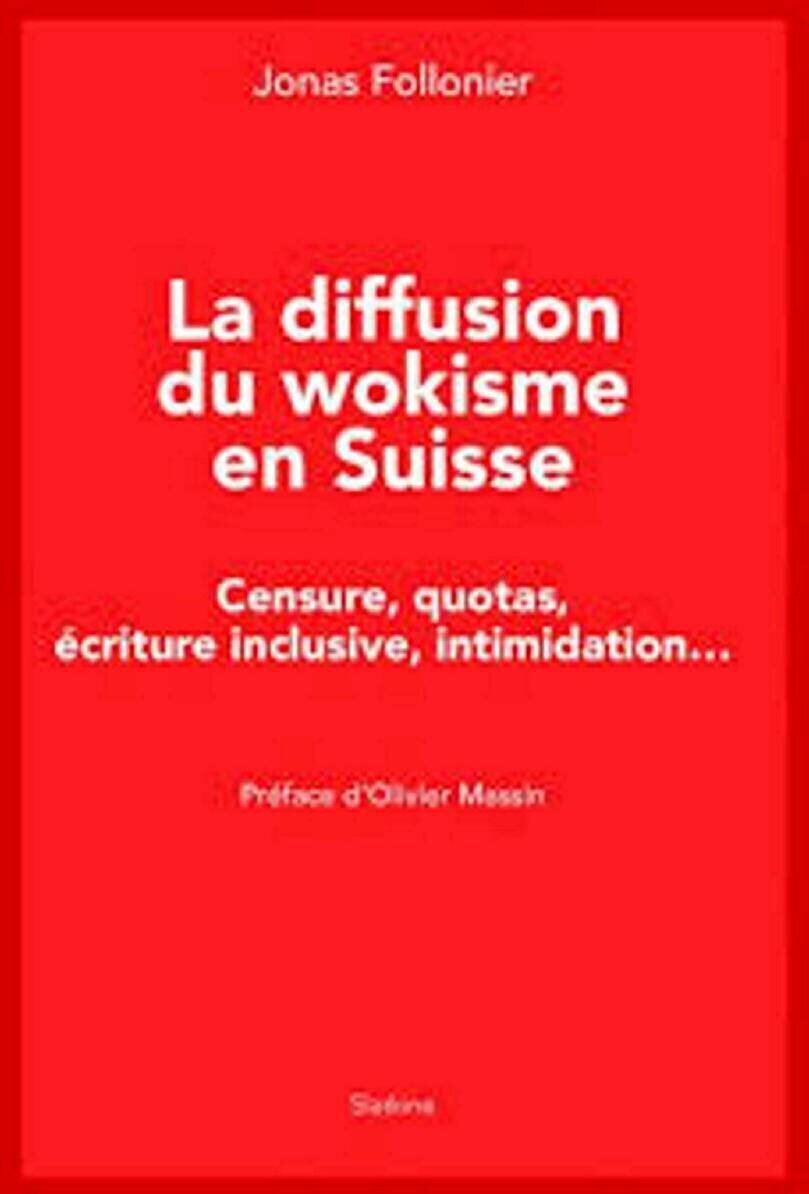Table of Contents
Un essai inattendu et retentissant vient de secouer la tranquillité suisse depuis sa parution le 4 octobre. *La Diffusion du wokisme en Suisse* (Slatkine), un ouvrage fouillé et documenté, propose une définition et une analyse du « wokisme » à travers une multitude de faits marquants de l’actualité helvétique des cinq dernières années. Le journaliste Jonas Follonier y aborde des événements variés, allant des annulations violentes de conférences d’enseignants au déboulonnage de statues dépourvues d’argument colonial, tout en dénonçant les critères militants imposés aux médias et aux productions culturelles suisses. Pour un public français, ce regard sur la société suisse et son militantisme radical apparaît captivant et même rassurant. Ce livre est également paru en France le 15 octobre.
Un sujet inédit abordé avec courage
Dans une interview, Jonas Follonier explique pourquoi il a choisi de traiter le sujet du wokisme en Suisse. Il souligne l’absence d’ouvrages sur cette thématique et évoque le déclencheur de son enquête : une série d’incidents survenus au printemps 2022 à l’université de Genève. Des activistes violents avaient empêché la tenue de conférences sur la question du « genre », illustrant ainsi la montée du wokisme dans le pays.
Critique des médias publics
Follonier consacre une partie de son livre à la critique des médias publics suisses, qu’il considère comme manquant de pluralité. Selon lui, les Suisses, qui paient une redevance audiovisuelle élevée (environ 400 euros par ménage), expriment des préoccupations quant à l’impartialité de l’information, notamment sur des sujets sociétaux. Il plaide pour une remise en question de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) face aux menaces que ressentent les citoyens.
Le cinéma sous l’influence du wokisme
Le marché du cinéma en Suisse, qui est très réduit, est également touché par cette tendance. Follonier s’interroge sur les critères de financement des projets cinématographiques, qui semblent privilégier la représentation des minorités au détriment de la qualité des œuvres. Il dénonce ainsi l’importation d’une idéologie américaine qui s’oppose aux traditions libérales et universalistes de la Suisse.
Une société divisée
Les résultats des sondages montrent que la majorité des citoyens suisses rejettent le wokisme, tout comme l’écriture inclusive. Cependant, dans les milieux médiatiques et universitaires, une peur de l’étiquetage en tant qu’extrême droite persiste. Follonier souligne que de nombreux membres de la droite modérée sous-estiment l’importance de ce phénomène, le considérant comme une mode passagère.
Réactions face à l’intolérance
En ce qui concerne les accusations dont a été victime Tariq Ramadan, Follonier observe un traitement médiatique similaire à celui de certains médias français. Alors que des militantes féministes suisses défendaient la présomption d’innocence dans ce cas, elles ont tardé à réagir à d’autres affaires d’agressions sexuelles. Ce double standard soulève des questions sur la manière dont les droits des femmes sont défendus selon le contexte.
Une mentalité suisse en jeu
Follonier évoque une culture du compromis typiquement suisse, où l’on tente de satisfaire à la fois les militants et ceux qui les critiquent. Cette mentalité contribue à un « semi-militantisme » qui complique le débat autour du wokisme. Le discours nuancé en Suisse contraste avec la polarisation observée en France, où les opinions sont souvent exprimées de manière plus tranchée.
Moins de violence, mais une intimidation persistante
Bien que la Suisse soit perçue comme un pays calme, Follonier évoque une violence symbolique et une intimidation qui existent, notamment à travers des cas de harcèlement médiatique. Il note qu’il a reçu plusieurs sollicitations médiatiques en relation avec son livre, prouvant que le débat autour du wokisme intéresse de nombreux Suisses.