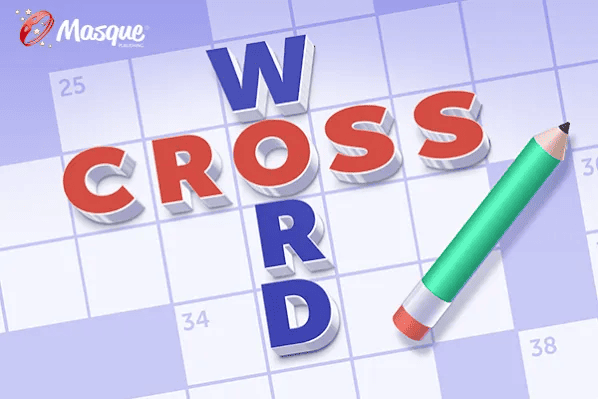Table of Contents
La route du Tōkaidō, axe majeur du Japon au XIXe siècle, reliait Edo (aujourd’hui Tokyo), centre du pouvoir shogunal, à Kyoto, siège impérial. S’étendant sur environ 500 kilomètres le long de la côte est de l’île d’Honshū, cette voie faisait partie des Gokaidō, cinq grandes routes instituées par le shogunat Tokugawa (1603–1867) pour renforcer le contrôle gouvernemental, le commerce et les déplacements.
Bordée de 53 relais officiels où voyageurs, seigneurs provinciaux, marchands et pèlerins pouvaient se reposer, commercer et changer de montures, le Tōkaidō était un véritable cœur économique et culturel. Pour l’artiste Utagawa Hiroshige (1797–1858), il devint une source inépuisable d’inspiration artistique.
Hiroshige, maître paysagiste de l’ukiyo-e
Hiroshige est aujourd’hui reconnu comme le plus grand paysagiste de l’ère ukiyo-e, période de deux siècles s’achevant au XIXe siècle, pendant laquelle le public occidental a découvert l’art japonais à travers portraits d’illustres courtisanes, paysages montagneux et les célèbres vagues d’Hokusai. Une importante exposition consacrée à son œuvre ouvrira bientôt au British Museum, soulignant sa voix artistique singulière, particulièrement visible dans ses représentations des paysages grandioses et scènes vibrantes de la route du Tōkaidō.
Son voyage le long de cette route, intégré à une délégation shogunale vers Kyoto, marqua un tournant décisif dans sa carrière. Parmi ses séries emblématiques figurent Les Cinquante-trois relais du Tōkaidō (1833–1834), Vues célèbres des soixante provinces (1853–1856) et Cent vues célèbres d’Edo (1856–1858). À travers ces œuvres, Hiroshige dévoile un Japon à la fois merveilleux et paisible, reflet d’une époque de paix prolongée sous un pouvoir centralisé et strict.
La censure qui façonne l’art
Malgré la beauté apparente de ses estampes, Hiroshige ne présentait pas une image complète du Japon. Les artistes ukiyo-e étaient soumis à la censure. Deux grandes vagues de répression marquèrent son époque. En 1804, le maître Kitagawa Utamaro et plusieurs confrères furent punis pour leurs œuvres socialement critiques ou érotiques, subissant des contraintes physiques et des amendes pour leurs éditeurs.
Une nouvelle vague de censure survint durant l’ère Tenpō (1830–1844), coïncidant avec la montée en renommée d’Hiroshige. Ses estampes de la route du Tōkaidō, très populaires auprès des voyageurs désireux de revivre leurs périples, furent soumises à un contrôle strict. Une autre série illustrant une route plus reculée, à travers les montagnes, reçut moins d’éloges, probablement en raison de son moindre attrait et du contexte restrictif.
Ce contexte explique le choix d’Hiroshige de privilégier les paysages aux scènes de la vie quotidienne à Edo ou dans le célèbre quartier rouge de Yoshiwara. Chaque estampe portait le cachet du censeur, preuve que même les représentations naturalistes étaient surveillées et limitées par un régime autoritaire.
Les absences révélatrices dans les compositions
Dans la série Cent vues célèbres d’Edo, Hiroshige évite soigneusement de représenter le vaste complexe du château shogunal, qui s’étendait sur plus de 280 hectares dans l’ouest de la ville. Pour des raisons militaires, toute image du château était interdite, malgré la paix durable depuis 1615. Cette omission n’est pas due à un oubli : ayant grandi près des douves du palais, fils d’un officier chargé de la sécurité du château, Hiroshige connaissait parfaitement ce monument.
Les troubles sociaux liés aux famines et épidémies, notamment durant l’ère Tenpō, représentaient les seuls dangers pour la stabilité du pays. Le shogunat exerçait un contrôle strict sur les daimyō (seigneurs provinciaux), qui devaient résider alternativement à Edo, un cérémonial que Hiroshige immortalisa avec la majesté des processions de samouraïs et serviteurs parcourant les routes.
Une vision idéalisée de la vie urbaine
Malgré une population approchant le million d’habitants à Edo au milieu du XIXe siècle, les scènes urbaines d’Hiroshige sont paradoxalement peu animées. Les personnages sont souvent lointains, vus de dos ou dissimulés sous de larges chapeaux de paille, leurs identités volontairement floues. Cette stylisation faisait partie des codes de l’ukiyo-e, qui valorisait les scènes narratives et idéalisées plutôt que des portraits réalistes de la société. Ces œuvres étaient commandées pour illustrer lieux célèbres, fêtes saisonnières et divertissements élégants.
Cette pratique n’était pas spécifique au Japon. En Occident, les artistes du XIXe siècle évitaient également de représenter les dures réalités sociales dans les grandes villes, préférant des visions romantiques et esthétisantes avant l’avènement de la photographie.
Une tradition romantique du voyage
Hiroshige poursuivait une tradition artistique consistant à idéaliser le voyage. Ses images montrent des porteurs et coursiers riant et plaisantant durant leurs périples, et non peinant sous le poids de leurs fardeaux. Ses commanditaires, comprenant seigneurs, marchands, samouraïs, femmes cultivées, cercles de poésie et collectionneurs d’estampes, préféraient les ponts pittoresques, les vagues spectaculaires, les lacs et montagnes lointains, ainsi que les paysages qu’ils ne pourraient peut-être jamais visiter.
Au cours des années 1840, Hiroshige fut reconnu comme le principal paysagiste d’Edo, parfois considéré comme l’équivalent terrestre d’Hokusai. Il réalisa souvent des commandes pour des lieux qu’il n’avait jamais vus, utilisant des descriptions littéraires et le travail d’autres artistes. Pour compenser cette méconnaissance, il emprunta aux techniques occidentales en plaçant des éléments à grande échelle au premier plan, créant ainsi une sensation de profondeur et fournissant des références précieuses aux artisans locaux.
Un artiste spirituel et visionnaire
En 1847, à 51 ans, Hiroshige adopta les préceptes confucéens et devint novice bouddhiste, prenant le nom de Tokubei. Peu d’informations subsistent sur sa vie personnelle, notamment ses deux mariages et son fils Nakajirō, mort jeune. Sa relation avec ses disciples, dont son successeur Shigenobu, reste ambiguë, même si ce dernier participa à sa dernière série publiée après la mort de l’artiste.
Ses journaux nous révèlent une personnalité profonde et sensible. En 1841, lors d’un voyage à Kofu, il composa un poème humoristique pour un vieil homme désireux d’écrire à un amour perdu. Il nota également une soirée passée dans une auberge partagée où un samouraï pratiquait des techniques de dégainage, qu’il dessina avec précision.
Profondément spirituel, Hiroshige exprima dans son dernier poème une acceptation paisible de la mort : « Je laisse mon pinceau à Azuma / Je pars pour la Terre de l’Ouest / Pour contempler les vues célèbres là-bas. ». Victime d’une épidémie de choléra, il mourut à Edo en 1858, laissant derrière lui un héritage de paysages éclatants, fenêtres sur un monde ordonné, façonné autant par la vision artistique que par les contraintes de son temps.