Table of Contents
En 2016, lors d’un discours pendant la campagne électorale, le président américain Donald Trump a déclaré que « l’islam nous déteste ». Ce n’était pas un simple lapsus ou un avis personnel, mais selon le réseau NBC News, ce propos reflète une vague globale croissante qui exploite la peur des musulmans, transformant ce sentiment en un levier politique, économique et médiatique.
Un rapport publié par le journal britannique The Guardian, s’appuyant sur une étude conjointe entre le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) et un centre de recherche de l’université de Berkeley en Californie, révèle que l’islamophobie est devenue une véritable industrie. Celle-ci mêle intérêts politiques, économiques et médiatiques pour créer des réseaux de pression et de financement promouvant une image déformée des musulmans, alimentant ainsi la peur dans les sociétés.
Cette dynamique ne se limite pas aux discours de haine individuels ou aux positions populistes, elle implique également des entreprises privées de sécurité, des centres de recherche financés, des médias idéologisés et des institutions juridiques prétendant défendre les valeurs occidentales, selon le journal.
Le rapport souligne que les campagnes coordonnées contre l’islam et les musulmans ne sont plus une simple réaction culturelle ou émotionnelle mais une machine lucrative, exploitant la peur de l’islam comme produit politique, sécuritaire et médiatique. Derrière chaque slogan ou stéréotype se cache un budget dissimulé et un réseau complexe d’acteurs qui financent et vendent cette haine.
Qui finance la peur des musulmans ?
Si beaucoup pensent que l’hostilité envers les musulmans provient d’individus ou de groupes extrémistes, la réalité démontre l’existence d’un réseau organisé finançant et orchestrant des campagnes systématiques d’islamophobie avec des budgets colossaux.
Dans un silence quasi général des gouvernements, le rapport du CAIR de 2021, intitulé « L’islamophobie dans le courant dominant », indique que plus de 106 entités américaines ont dépensé environ 105 millions de dollars entre 2017 et 2019 pour soutenir des discours haineux à l’encontre des musulmans.
Ces organisations prétendent travailler dans le domaine de la recherche et des politiques publiques, mais elles constituent en réalité la colonne vertébrale de l’industrie islamophobe, notamment :
- Le Middle East Forum, dirigé par l’écrivain conservateur Daniel Pipes, se présente comme une plateforme intellectuelle, publiant fréquemment des rapports associant islam, extrémisme et menace sécuritaire. Il pilote des projets tels que “Surveillance des campus” et “Surveillance des islamistes” visant les musulmans dans les espaces académiques et publics.
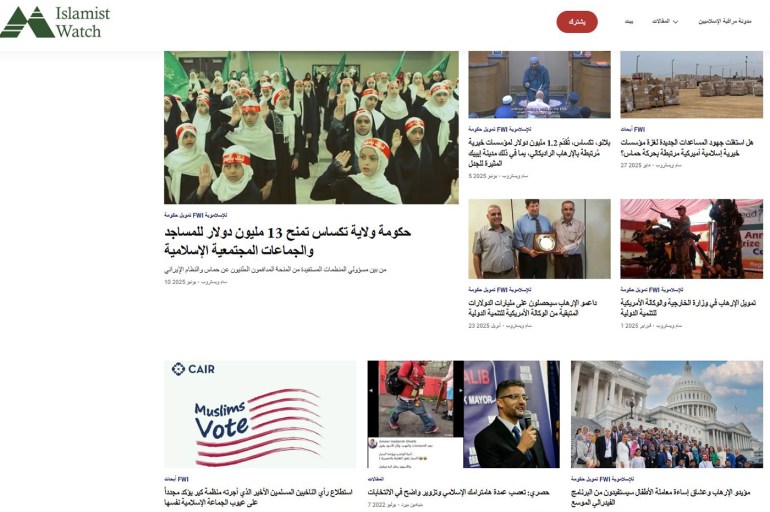
- ACT for America, l’un des plus grands groupes anti-musulmans aux États-Unis, fondé par Brigitte Gabriel, prônant une surveillance stricte des mosquées et l’interdiction de la charia. Cette organisation est classée comme groupe haineux par le Southern Poverty Law Center (SPLC) à cause de son discours haineux.
- Le David Horowitz Freedom Center, qui finance des contenus anti-musulmans, associant islam et terrorisme à travers de nombreux rapports et articles destinés aux médias et aux décideurs.
- Des sites comme “Jihad Watch” et “FrontPage Magazine”, qui jouent un rôle central dans la diffusion de l’islamophobie.
Selon une initiative de la Georgetown University, ces organisations bénéficient de financements sous forme de dons exonérés d’impôts, ce qui implique une légitimation et un soutien financier indirect du gouvernement américain.
Des familles conservatrices fortunées, comme la famille Mercer, sont identifiées comme principales donatrices, soutenant aussi des sites d’extrême droite.
Le rapport souligne que ce réseau ne se limite pas à la production de contenus mais vise également à influencer les législations et politiques à travers le financement de campagnes électorales et la fourniture de témoignages biaisés lors d’auditions officielles.
En résumé, l’islamophobie est devenue une stratégie politique et économique, soutenue par un réseau de financement étendu et puissant.
La peur comme produit commercial
Un rapport de la plateforme Mondoweiss souligne que les entreprises privées de sécurité, la police et les centres de formation militaire ont investi dans la peur de l’islam en proposant des formations axées sur la soi-disant “menace islamique”. Ils excluent le traitement du terrorisme d’extrême droite, pourtant plus réel et croissant en Occident.
L’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) a révélé que plusieurs municipalités et services de sécurité ont signé des contrats avec des entreprises privées pour organiser des ateliers de formation policière sur “le terrorisme islamique”. Ces formations, souvent truffées de préjugés et de clichés, utilisent des termes comme “jihad”, “charia” ou “voile” comme indicateurs de radicalisation, ignorant la diversité culturelle et religieuse des communautés musulmanes.
Un exemple marquant, révélé par The Guardian, est le programme de surveillance mené par la police de New York entre 2002 et 2014, qui a ciblé mosquées, restaurants, centres islamiques et étudiants musulmans sans aucune preuve d’activités suspectes.
Des poursuites judiciaires ont condamné ces pratiques illégales, obligeant la police à cesser ces méthodes.
Ce qui attire particulièrement l’attention est que les entreprises fournissant le contenu et organisant ces formations ont engrangé des millions de dollars grâce à des contrats signés avec des municipalités, départements de la sécurité, voire le Département de la Défense américain.
Ces sociétés internationales de sécurité proposent avant tout des programmes qui dépeignent les musulmans comme une menace potentielle, sans distinction entre musulmans ordinaires et extrémistes, contribuant ainsi à renforcer des stéréotypes dangereux.
En Europe, des programmes similaires financés par des gouvernements, comme le programme “Prevent” au Royaume-Uni, prévoient des formations et des guides qui assimilent la pratique religieuse musulmane, y compris la prière régulière, à un risque potentiel.
Le Centre international pour la lutte contre le terrorisme souligne que ces programmes sont inefficaces pour combattre le radicalisme. Au contraire, ils alimentent les préjugés, exacerbent l’hostilité et le sentiment de marginalisation dans les quartiers musulmans, transformant la lutte antiterroriste en un outil de division.
Cette industrie de la peur ne se limite pas aux discours : elle englobe contrats sécuritaires, subventions publiques et programmes de formation qui enrichissent principalement des entreprises spécialisées dans la vente de sécurité fondée sur l’hostilité envers les musulmans.
Les médias à la solde et la fabrication de l’opinion publique
Le Centre européen de surveillance du racisme et de la xénophobie (EUMC) a décrit dans un rapport intitulé « Islamophobie et médias en Europe après le 11 septembre » le rôle central des médias dans la construction de l’image du musulman comme une menace.
Souvent, les médias servent les intérêts politiques ou économiques qui commercialisent l’islamophobie. Au lieu d’être un espace de correction, beaucoup de plateformes occidentales recyclent les stéréotypes via leurs actualités, titres, émissions et parfois même des œuvres dramatiques.
Une étude de l’université de Stanford en 2020 montre que les crimes commis par des musulmans bénéficient d’une couverture médiatique supérieure de 357 % par rapport à ceux commis par non-musulmans, même lorsque les actes sont similaires.
Cette différence se manifeste aussi dans le vocabulaire : le terme « terroriste » est systématiquement utilisé si l’auteur est musulman, alors qu’on parle de « tireur » ou de « personne perturbée » pour d’autres.
En France, un rapport de 2022 du Conseil supérieur de l’audiovisuel observe que certaines chaînes comme CNews ou des magazines comme Valeurs Actuelles insistent de manière récurrente sur les thèmes de l’immigration, de la sécurité et de l’islam en les associant systématiquement à la violence ou à la menace sociale.
Plus de 60 % des reportages sécuritaires mentionnent les musulmans, alors qu’ils représentent moins de 10 % de la population, la majorité n’ayant aucun lien avec la criminalité.
L’usage d’images type – mosquées, femmes voilées, appels à la prière – dans les reportages liés à la violence, même quand l’auteur n’a aucun rapport avec l’islam, renforce inconsciemment l’idée que le musulman incarne un danger.
Cette association visuelle et verbale conditionne progressivement les esprits à accepter des politiques discriminatoires sous couvert de « protection ».
Au-delà de la partialité dans la couverture médiatique, un contenu systématique alimente la haine envers les musulmans.
Un rapport de l’Université de Californie du Sud en 2021, intitulé « Manquants et déformés : la réalité des musulmans dans le cinéma mondial », a analysé 200 films entre 2001 et 2020. Il en ressort que plus de 80 % des personnages musulmans sont liés à la violence, au fanatisme ou à la menace, tandis que seulement 3 % apparaissent comme des personnages normaux ou positifs.
Certains journalistes américains, comme Ben Shapiro, fondent leur notoriété sur des positions hostiles à l’islam sur des chaînes telles que Daily Wire, financées par les mêmes réseaux qui soutiennent les centres de production islamophobes aux États-Unis.
Le constat est clair : les médias jouent un rôle central dans la promotion de la haine, la consolidation des stéréotypes et la justification des politiques discriminatoires anti-musulmanes en Occident.
Les conséquences de l’islamophobie sur la vie des musulmans
Selon un rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2021, l’islamophobie dépasse le simple discours ou opinion passagère. Elle engendre des conséquences quotidiennes lourdes pour des millions de musulmans, notamment en Occident et dans d’autres régions où ce discours est diffusé directement ou indirectement.
Lorsque la haine devient politique, médiatique et législative, ses impacts sont multiples : psychologiques, matériels et sociaux.
Les chiffres du FBI montrent une augmentation significative des crimes haineux contre les musulmans après chaque grand incident impliquant un suspect musulman, ou après des déclarations hostiles de personnalités publiques.
Par exemple :
- Augmentation de 67 % des signalements après l’élection de Trump en 2016, en lien avec ses discours incendiaires.
- Hausse des agressions physiques et verbales contre les femmes voilées.
- Multiplication des menaces contre mosquées et centres islamiques.
Une étude britannique de 2020 menée par le centre Tell Mama révèle que plus de 80 % des femmes musulmanes ont subi des formes de harcèlement ou de discrimination lorsqu’elles portent le voile en public, au travail ou dans les administrations.
En France, un article du journal Le Monde de 2024 souligne que le discours politique anti-islam a conduit à des lois interdisant les signes religieux à l’école et dans les administrations, avec des débats en cours pour étendre ces restrictions aux écoles privées et aux espaces publics.
Cette situation crée chez de nombreux musulmans le sentiment d’être constamment surveillés et obligés de justifier leur existence et leur intégration selon les critères de l’État plutôt que de la société française.
Une étude de l’université de Manchester en 2018 met en lumière des taux d’anxiété et de dépression plus élevés de 50 % chez les jeunes musulmans britanniques, dus à la discrimination et la mauvaise représentation médiatique. Beaucoup expriment un sentiment d’errance et une pression constante pour prouver leur loyauté nationale, tout en devant réfuter des accusations infondées.
Sur le plan politique, l’organisation Human Rights Watch observe l’usage de l’islamophobie comme prétexte populiste pour des mesures répressives telles que la surveillance des mosquées, la fermeture d’associations islamiques, la réduction des visas et la restriction des ONG.
Dans certains cas, toute contestation ou opinion musulmane dissidente est assimilée à une forme d’extrémisme, marginalisant encore plus cette communauté et poussant nombre d’entre eux à l’isolement ou au retrait politique.
Human Rights Watch conclut que cette industrie de la peur ne nuit pas qu’aux musulmans, mais fracture le tissu social, sème la méfiance entre groupes et légitime les violations des principes de liberté et d’égalité. La perte est donc collective pour les sociétés qui tolèrent la haine institutionnalisée.
Face à cet entrelacs complexe de politiques, médias et intérêts économiques, l’islamophobie apparaît bien plus qu’un simple biais ; c’est un système lucratif qui alimente la haine et légitime l’exclusion.
Le danger majeur réside dans le fait que les sociétés acceptant de transformer la peur en commerce et la discrimination en loi compromettent ainsi leurs fondements éthiques et leur unité pour l’avenir commun.

