Table of Contents
Le Centre suisse islam et société (CSIS), basé à l’Université de Fribourg, célèbre cette année ses dix ans d’existence. Cette institution singulière en Suisse a permis d’intégrer la communauté musulmane dans le champ des études scientifiques, offrant ainsi une meilleure compréhension de l’islam dans le contexte suisse. Rencontre avec Amir Dziri, co-directeur du centre, qui revient sur cette décennie d’engagement académique et social.
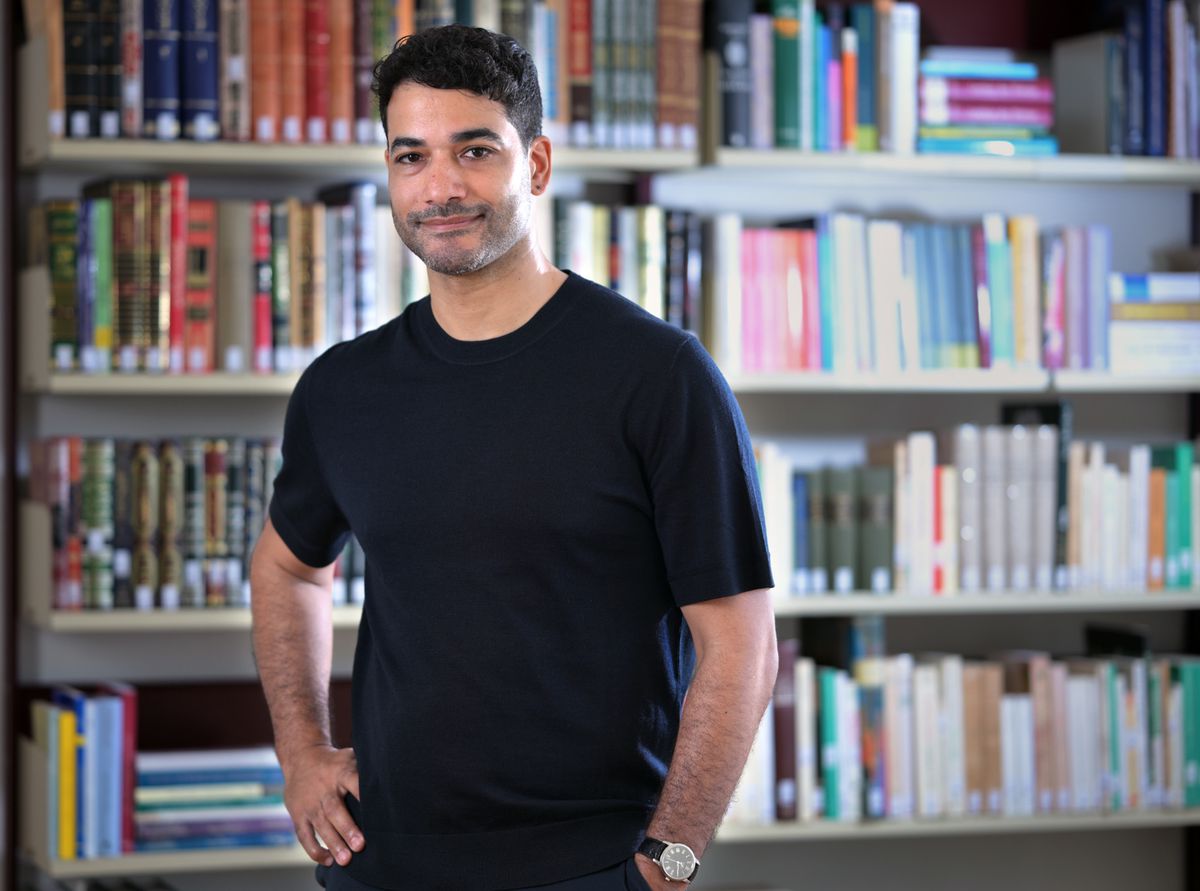
Un centre unique face aux défis de l’intégration
Le CSIS, fondé en 2015 sous l’égide des facultés de théologie, droit et lettres, a souvent été perçu à tort comme une école religieuse destinée à la formation d’imams. Cependant, son objectif est bien plus large : comprendre la réalité suisse et favoriser l’intégration des imams dans le contexte culturel local. Cette initiative est née quelques années après la votation controversée sur les minarets, un événement qui a fortement marqué le climat social et politique en Suisse.
Arrivé à Fribourg en 2017, Amir Dziri témoigne des tensions initiales. « À l’époque, l’islam en Suisse était une véritable boîte noire. On ne connaissait presque rien des acteurs, des associations, des thématiques liées à cette communauté », explique-t-il. Malgré des débats parfois houleux et une initiative politique visant à interdire le centre, cette période a permis de poser des bases solides pour un dialogue constructif.
Intégrer l’islam dans les études académiques
Le CSIS vise à inscrire l’islam dans un cadre scientifique et académique, aidant notamment les imams vivant ou arrivant en Suisse à mieux comprendre leur environnement. Le public étudiant est très varié, mêlant étudiants musulmans engagés dans des associations et étudiants d’autres horizons, souvent non musulmans, intéressés par les sciences religieuses, sociales ou juridiques.
Cette diversité est essentielle pour nourrir les échanges et enrichir la vie universitaire. Elle contribue à dépasser les clichés et à offrir une lecture nuancée des réalités musulmanes en Suisse, loin des catégories simplistes qui dominaient auparavant.
Évolution du débat et rôle des imams
En dix ans, le débat autour de l’islam s’est considérablement assoupli. La distinction réductrice entre « bons » et « mauvais » musulmans a laissé place à une compréhension plus fine et plurielle des positions dans les communautés. « Nous avons réussi à démontrer qu’il existe une grande diversité de points de vue », souligne Amir Dziri.
Les imams, autrefois cantonnés à la prière, ont vu leur rôle évoluer. Ils s’impliquent désormais dans le dialogue interreligieux, répondent aux sollicitations des médias et s’interrogent sur les besoins spécifiques des jeunes musulmans en Suisse. Ces figures sont devenues des ambassadeurs au-delà de leur seule communauté religieuse.
Conflits internationaux et répercussions locales
Les événements récents, tels que le massacre du 7 octobre et le conflit entre Israël et le Hamas, ont aussi un impact sur le travail du CSIS. « Nous étudions depuis longtemps le dialogue judéo-musulman et les formes d’antisémitisme dans certaines communautés musulmanes », précise Amir Dziri. Le centre met en garde contre les confusions simplistes qui associent automatiquement les juifs à Israël et les musulmans à la Palestine, alors qu’il s’agit de questions politiques complexes distinctes des identités religieuses.
Cette situation est exacerbée par un contexte global, notamment aux États-Unis, où les sciences humaines sont parfois perçues comme des champs de bataille idéologiques. Malgré ces défis, le CSIS continue de défendre l’importance des sciences humaines comme fondement essentiel à la compréhension et à la cohésion sociale.
En résumé :
- Le Centre suisse islam et société fête dix ans d’existence académique à l’Université de Fribourg.
- Il favorise l’intégration des imams dans le contexte culturel suisse contemporain.
- Le CSIS joue un rôle clé dans la réduction des préjugés et la promotion du dialogue intercommunautaire.

