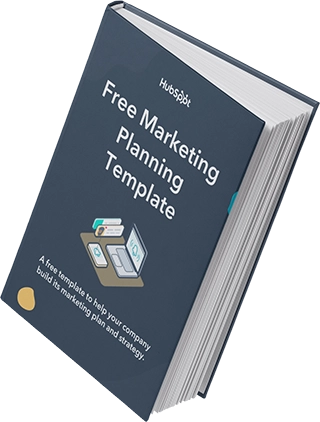Table of Contents
La stratégie marketing s’appuie souvent sur des mécanismes psychologiques simples : en associant des stimuli, les marques modifient nos perceptions et nos comportements. L’exemple le plus ancien reste celui d’Ivan Pavlov et du conditionnement classique, qui explique en partie pourquoi un parfum, un son ou une température peuvent devenir des leviers commerciaux puissants.
Comment la stratégie marketing exploite l’association et le conditionnement
À la fin du XIXe siècle, le physiologiste russe Ivan Pavlov observa que des chiens salivent non seulement à la vue de la nourriture, mais aussi au bruit des pas de la personne qui apporte cette nourriture. Dans ses expériences, il faisait sonner une cloche juste avant de donner à manger ; après plusieurs répétitions, le son seul déclenchait la salivation. Pavlov avait identifié le conditionnement classique : l’apprentissage d’une association entre un stimulus (la cloche) et un autre stimulus (la nourriture), produisant une réponse conditionnée (la salivation).
Appliqué aux humains, ce mécanisme explique pourquoi nous en venons à apprécier des sensations qui, à l’origine, ne nous évoquaient rien. Le conditionnement permet aux marketeurs de créer des liens durables entre une marque et des expériences plaisantes, et d’intégrer ces associations au branding et aux campagnes publicitaires.
Exemples concrets : automobile, bière et boutiques de luxe
Le « parfum de voiture neuve » illustre bien ce processus. Personne ne naît en aimant cette odeur ; elle devient agréable parce qu’elle est répétitivement associée à l’expérience plaisante d’un véhicule propre et flambant neuf. Charles Spence, dans son ouvrage Sensehacking, décrit une pratique chez Rolls‑Royce : après un passage au service, certaines voitures revenaient à leurs propriétaires comme « différentes et meilleures » selon la clientèle.
“People say they don‘t understand what we’ve done, but that their cars come back different and better.”
La marque, citée par Spence et par des responsables comme Hugh Hadland, aurait obtenu cet effet en pulvérisant un mélange aromatique cuir‑bois pour recréer ce parfum distinctif. Ce parfum a même été commercialisé par la marque sous la forme d’un parfum destiné à prolonger l’odeur caractéristique d’une Rolls‑Royce.
Les constructeurs automobiles n’en restent pas là. Des études montrent l’impact du son sur la perception de vitesse : une étude de 2011 relève que des étudiants ont surestimé la vitesse d’une voiture lorsque le bruit du moteur était artificiellement renforcé. De même, une étude de 2008 indique qu’une réduction du bruit intérieur de 5 décibels conduisait les sujets à sous‑estimer la vitesse de 10 %. Sur la base de ces associations entre son et vitesse, certains modèles utilisent des actionneurs sonores pour amplifier la sonorité du moteur et renforcer l’impression de performance.
Autre cas repéré par Spence : le lien récurrent entre logos étoilés et bières. Des marques comme Estrella, Heineken, Newcastle Brown Ale et Sapporo intègrent une forme d’étoile dans leur identité visuelle ; en Indonésie, l’étoile de Bintang est omniprésente, et au Nigeria une bière très vendue se nomme littéralement Star Lager. Selon Spence, l’angularité d’une étoile rappelle la carbonatation et l’amertume, et incite à percevoir la boisson comme rafraîchissante.
Enfin, la recherche de Lisa Heschong dans Thermal Delight in Architecture (1979) montre que les magasins de marques de luxe sont en moyenne sensiblement plus froids que les enseignes non‑luxe. Heschong avance que ce refroidissement délibéré provient d’une époque où la climatisation était un luxe réservé aux établissements les plus riches ; aujourd’hui encore, la température peut servir d’indice symbolique dans le branding des espaces commerciaux.
Les implications pour le branding et la pratique marketing
Ces exemples illustrent comment l’association sensorielle et le conditionnement peuvent être exploités dans une stratégie marketing concrète. En créant ou en renforçant des liens entre stimuli (odeur, son, température, forme), les marques influent sur la perception du produit et sur la valeur perçue par le consommateur.
Le pouvoir de ces associations est double : d’une part, il consolide l’identité de marque en ancrant des signaux sensoriels dans l’expérience client ; d’autre part, il permet de corriger ou de renforcer une impression — par exemple, faire paraître une voiture « plus neuve » ou une boisson « plus rafraîchissante ». Ces techniques montrent que le conditionnement n’est pas réservé aux laboratoires : il est au cœur des pratiques de branding modernes.
En fin de compte, les recherches citées confirment que nous restons sensibles aux associations apprises. Jingles, bruits de moteur, parfums ou ambiances thermiques fonctionnent comme des déclencheurs conditionnés—et les marketeurs avisés s’en servent pour mieux vendre.