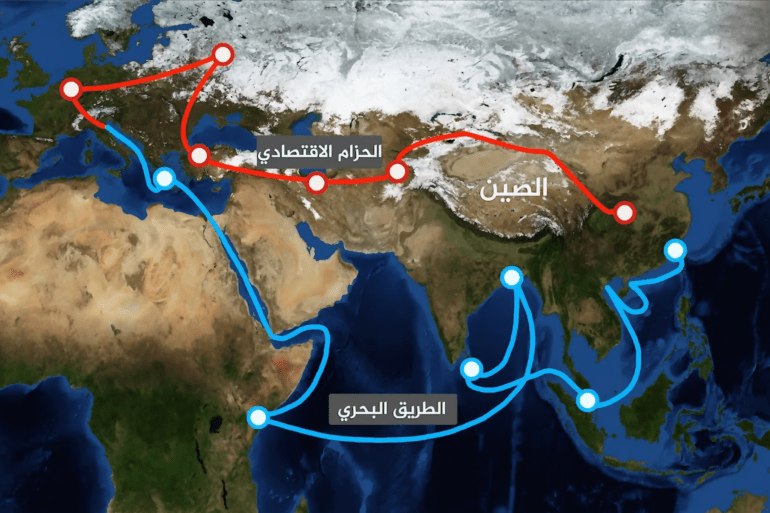Table of Contents
Plan de Beijing pour contrôler Taïwan sans combat en 2024
À la fin de la révolution chinoise, les forces de l’Armée populaire de libération ont imposé un siège continu sur la capitale de l’époque, Péping (aujourd’hui Pékin). Après plusieurs semaines, en janvier 1949, la ville est tombée sans combat, suite à la reddition du commandant local. Cet événement marqua le début de l’effondrement progressif des forces du Kuomintang (KMT) — le parti nationaliste au pouvoir — avec la chute successive des villes et villages sans résistance notable. Ce scénario est aujourd’hui désigné par les Chinois comme le « modèle Péping », terme populaire au sein du parti communiste pour décrire la stratégie envisageable pour faire tomber Taïwan sans recourir aux armes, complétant ainsi la révolution et corrigeant le cours de l’histoire en éliminant les derniers bastions du KMT, réfugiés sur l’île depuis décembre 1949 lors du « grand repli » avec près de deux millions de soldats et membres du parti.
Les anticipations américaines face à un éventuel conflit
Ces dernières années, les États-Unis se préparent intensément à la possibilité d’une invasion militaire de Taïwan par Pékin et son annexion au territoire continental. Ils réorganisent leurs capacités stratégiques dans la zone indo-pacifique en prévision d’un moment charnière qui pourrait redéfinir l’équilibre des pouvoirs dans l’ère post-guerre froide.
En 2021, l’amiral Philip Davidson, ex-commandant des forces américaines dans la région indo-pacifique, a témoigné devant la commission des forces armées du Sénat en anticipant une opération d’invasion amphibie de Taïwan par la Chine dans la décennie à venir, possiblement dans les six prochaines années, une période depuis connue comme la « fenêtre Davidson ».
En février 2023, William Burns, ancien directeur de la CIA, a confirmé lors d’une interview télévisée que le président chinois Xi Jinping avait ordonné à l’armée d’être prête à envahir Taïwan d’ici 2027.
Une alternative à l’invasion militaire : la stratégie du contrôle sans combat
Malgré ces prévisions, le comportement observé de la Chine autour de Taïwan laisse penser que l’invasion amphibie n’est pas la seule option envisagée. Pékin disposerait d’un plan alternatif visant à soumettre Taipei sans guerre ouverte, rappelant ainsi la chute pacifique de Péping il y a plus de 70 ans.
Cette stratégie éviterait un siège militaire traditionnel, considéré comme un acte de guerre selon le droit international, susceptible de provoquer des réactions internationales sévères, notamment américaines. Au lieu de cela, elle reposerait sur un réseau complexe de pressions sécuritaires en deçà du seuil de la guerre, combinant des influences politiques, économiques et médiatiques pour affaiblir progressivement la résistance taïwanaise et éroder son attachement à l’indépendance, conduisant à une capitulation sans affrontement.
Les méthodes d’influence et de coercition employées par Pékin
« Le summum de l’art de la guerre est de soumettre l’ennemi sans combattre »
Sun Tzu, stratège chinois du VIe siècle av. J.-C., dans « L’Art de la guerre »
La guerre n’est donc pas uniquement un affrontement violent, mais un combat complexe utilisant tous les moyens — militaires ou pacifiques — pour modifier la volonté adverse et briser sa capacité de résistance, atteignant ainsi les objectifs politiques et stratégiques du vainqueur.
Depuis plusieurs années, sans recourir à une démonstration excessive de force, la Chine impose progressivement sa souveraineté sur Taïwan à travers diverses formes de coercition multiformes. Ces actions incluent :
- Manœuvres militaires fréquentes, notamment des tirs de missiles près des eaux taïwanaises dans le cadre d’exercices, telles que les manœuvres « Épée commune » de 2023.
- Accusations d’actes de sabotage, comme la coupure de câbles maritimes au nord de Taïwan en février 2024.
- Multiplication par quatre des incursions quotidiennes d’avions de combat chinois dans l’espace aérien taïwanais entre 2019 et 2023.
Ces démonstrations, bien qu’elles ne constituent pas un siège militaire effectif, exercent une pression psychologique importante sur la population insulaire, rappelant constamment le coût potentiel d’une tentative de séparation.
Pressions économiques et diplomatiques
Outre les aspects militaires, Pékin a instauré des restrictions ciblées :
- Limitation des voyages des citoyens et étudiants chinois vers Taïwan depuis 2016, affectant sévèrement les secteurs du tourisme et de l’enseignement supérieur.
- Interdiction d’importations agricoles clés telles que les ananas et les pommes en 2021-2022, portant un coup dur à l’agriculture taïwanaise.
- Utilisation d’incitations économiques pour attirer les alliés diplomatiques de Taïwan, provoquant un basculement de plusieurs États du Pacifique vers la reconnaissance de la République populaire de Chine.
De 2016 à 2024, dix pays ont quitté les rangs des alliés diplomatiques de Taïwan, réduisant leur nombre de 22 à seulement 12.
Par ailleurs, Pékin exploite également les liens culturels pour influencer l’opinion taïwanaise, présentant la réunification non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Un exemple récent est la diffusion, début 2024, d’une vidéo festive spécialement conçue pour le public taïwanais par l’armée populaire de libération, mettant en scène des échanges amicaux entre étudiants chinois et taïwanais.
Impact sur l’opinion publique taïwanaise
Des sondages réalisés début 2024 indiquent :
- Une baisse du soutien à l’indépendance depuis 2020.
- Plus de 80 % des Taïwanais souhaitent maintenir le « statu quo ».
- Seulement 20 % estiment que ce statu quo est viable à long terme.
- Environ 30 % anticipent une future réunification avec la Chine continentale, une hausse de 8 % par rapport à 2020.
Ces chiffres témoignent de l’efficacité croissante de la guerre psychologique chinoise.
Réseaux d’influence et espionnage doux
Des rapports récents à Taipei font état d’une intensification des tentatives chinoises de recrutement de politiciens locaux et d’acteurs civils influents, utilisant des incitations financières, des opportunités de formation et de voyages. Il ne s’agit pas d’un réseau d’espionnage traditionnel, mais d’un système d’influence subtil visant à modifier l’orientation politique de l’île sur le long terme.
Depuis quatre ans, le nombre de procès pour espionnage a quadruplé dans les tribunaux taïwanais. Depuis mars 2024, plusieurs membres du parti au pouvoir, y compris un assistant présidentiel, ainsi que des militaires chargés de la sécurité présidentielle, font l’objet d’enquêtes pour espionnage au profit de la Chine.
En outre, Pékin est accusé d’utiliser des réseaux de faux comptes sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations et vidéos favorisant la narrative selon laquelle le Parti démocrate progressiste (DPP) — au pouvoir — serait un instrument américain déstabilisant l’île par des politiques séparatistes, au service des intérêts géopolitiques américains.
En 2024, les autorités taïwanaises ont identifié plus de 2,16 millions de contenus qualifiés de « désinformation » et liés à la Chine, soit une hausse de 60 % par rapport à l’année précédente, amplifiée par l’usage de l’intelligence artificielle pour créer et diffuser ces messages.
En 2019, le journal Financial Times révélait que le groupe Want Want Media, propriétaire de plusieurs médias majeurs à Taïwan, recevait des directives éditoriales directes du Bureau des affaires taïwanaises du gouvernement chinois, influençant notamment les résultats des élections locales et les primaires présidentielles en faveur de candidats pro-unification.
Crise politique à Taïwan et rôle de la Chine
Cette toile d’influence complexe a exacerbé une profonde fracture politique à Taïwan, risquant d’entraîner une crise prolongée. Le président Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste, prône un discours indépendantiste inédit, affirmant que Taïwan est déjà un État de facto, et soutient une identité taïwanaise distincte.
Le Conseil législatif est dominé par le Kuomintang (KMT), qui ne prône pas ouvertement la réunification mais privilégie des relations apaisées avec Pékin et s’oppose à toute escalade. Les dirigeants du KMT accusent régulièrement le DPP de mener le pays vers un affrontement inutile avec la Chine.
Récemment, le parti présidentiel a lancé une campagne populaire pour destituer des députés KMT, les accusant de collusion avec la Chine pour affaiblir Taïwan. Le chef de la faction parlementaire KMT, Fu Kun-chi, a rencontré en 2023 des responsables chinois dont Wang Huning, haut cadre du Parti communiste chargé de la politique taïwanaise, où ils ont évoqué leur unité familiale et la collaboration pour empêcher l’indépendance.
Evolution du pouvoir législatif et tensions internes
À leur retour, les députés KMT ont adopté une loi élargissant les pouvoirs du Parlement au détriment du président. Après l’annulation partielle de cette loi par la Cour constitutionnelle, ils ont fait passer une autre loi paralysant cette même Cour.
En janvier 2024, ils ont procédé à des coupes budgétaires sévères, notamment dans les domaines de la défense, de la garde côtière et de la cybersécurité. Le président accuse le Parlement de compromettre la sécurité de l’île au profit de la Chine en réduisant le budget militaire, envoyant un signal négatif aux alliés. En revanche, les législateurs du KMT reprochent au président d’augmenter les dépenses militaires pour provoquer Pékin et risquer l’avenir de Taïwan.
Un exemple illustrant l’influence chinoise est celui de Fu, député de la province agricole et touristique de Hualien, qui avait vu ses exportations de pomélo interdites par Pékin en 2022. Après sa visite à Pékin, la Chine a levé l’interdiction sur ce produit local, mais pas dans les régions favorables au DPP, renforçant ainsi la popularité du chef du KMT.
Les tactiques de la « zone grise » : une alternative sécurisée pour Pékin
Une étude du Center for Strategic and International Studies (CSIS) suggère que la préparation à une invasion amphibie n’est pas la priorité absolue des États-Unis pour protéger Taïwan.
Elle souligne que la politique patiente et à long terme de la Chine, considérant la réunification comme une « fatalité historique », combinée à son expérience militaire limitée à l’étranger, indique que Pékin privilégiera probablement des « opérations en zone grise ».
Ces tactiques consistent en des actions coercitives militaires et économiques qui restent en dessous du seuil légal de la guerre, telles que :
- L’imposition par les forces paramilitaires chinoises, telles que la garde côtière et la police maritime, d’un « quarantaine » sur les mouvements maritimes et aériens autour de Taïwan.
- Le blocage partiel ou total des ports taïwanais, interrompant l’accès aux approvisionnements vitaux, notamment en énergie, sans intervention directe de l’armée.
- La mise en place d’exigences douanières strictes et l’interruption des opérations de fret en cas de non-conformité.
Cette approche se distingue juridiquement du « blocus » militaire, car elle relève de la loi des forces de l’ordre plutôt que d’une action militaire. Le port de Kaohsiung, principal point d’entrée maritime de Taïwan, pourrait être une cible stratégique majeure, responsable de 57 % des importations maritimes, notamment énergétiques.
Le coût d’une guerre ouverte
Malgré l’énorme déséquilibre militaire en faveur de la Chine, Pékin est consciente que l’invasion et l’occupation de Taïwan resteraient extrêmement difficiles pendant des décennies, même si les États-Unis et leurs alliés demeuraient neutres.
La traversée maritime de huit heures sur des embarcations vulnérables exposerait les forces chinoises aux tirs nourris de l’armée taïwanaise, composée de près de 130 000 soldats équipés de technologies modernes, soutenus par 1,5 million de réservistes et des milliers de véhicules blindés et d’artillerie automotrice camouflée.
Seulement 10 % du littoral taïwanais est propice à un débarquement amphibie. En cas d’attaque surprise, les forces taïwanaises pourraient concentrer leurs défenses sur ces zones, infligeant de lourdes pertes à l’envahisseur.
De plus, l’Armée populaire de libération n’a aucune expérience récente dans les opérations amphibies en environnement de combat moderne, ces opérations nécessitant une coordination complexe entre forces aériennes, terrestres et navales, sans compter les difficultés liées à l’occupation ultérieure de l’île.
Ces défis ne signifient pas que la Chine ne puisse pas prendre militairement le contrôle de Taïwan, mais plutôt que ce ne sera pas une opération aisée ou rapide. Cette réalité favorise la patience historique chinoise, comparable à la construction prolongée de la Grande Muraille, et laisse envisager que Pékin poursuivra ses manœuvres d’influence jusqu’à ce que Taïwan tombe silencieusement, sans combat.