Table of Contents
L’affrontement économique et stratégique entre Washington et Pékin — le conflit USA‑Chine — redessine les lignes politiques mondiales. Un débat récent relance deux lectures opposées de l’histoire : d’un côté la thèse de la fin de l’histoire, prônée par Francis Fukuyama ; de l’autre, la lecture sombre de Carl Schmitt sur la fragilité de la libéralité face aux crises. Ce texte examine comment la montée de la Chine a contribué à pousser les États‑Unis vers des pratiques moins libérales, parfois conformes aux analyses schmittiennes.
La thèse de Fukuyama et son renversement
En 1992, Francis Fukuyama soutenait que la démocratie libérale et le capitalisme de marché représentaient l’aboutissement de l’évolution politique humaine. Pour lui, ces modèles ouvriraient la voie définitive, même si tous les pays ne les adoptaient pas simultanément.
Au tournant des années 2000, la conviction dominait parmi les élites que la mondialisation, l’Internet et le commerce inciteraient les États non démocratiques à converger vers la libéralité. Bill Clinton affirmait alors que l’entrée de la Chine à l’OMC favoriserait non seulement les échanges, mais aussi une ouverture économique porteuse de libertés.
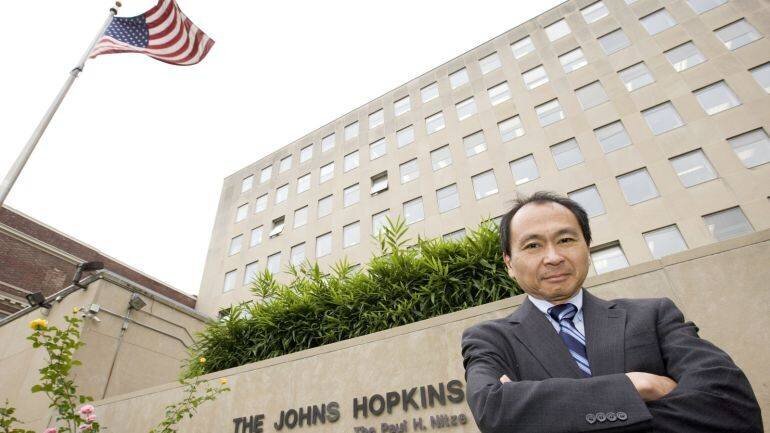
Le résultat fut l’inverse. Depuis l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001, son économie a connu une croissance spectaculaire sous un régime de « capitalisme d’État » à parti unique. Entre 2001 et les années suivantes, la croissance cumulée a été colossale, tandis que Pékin amplifiait le soutien public aux entreprises nationales et renforçait le contrôle politique et technologique interne.
Plutôt qu’une ouverture vers la libéralité, la Chine a maintenu des pratiques contraires aux règles du commerce international : appropriation de la propriété intellectuelle, transferts forcés de technologies, espionnage économique et subventions massives aux acteurs locaux.
Chimerica et la transformation politique américaine
L’interdépendance économique sino‑américaine, décrite par l’historien Niall Ferguson sous le terme « Chimerica », a produit des effets profonds sur les sociétés américaines.
Le « choc chinois » — la perte d’emplois manufacturiers et l’effondrement de communautés industrielles — a alimenté une colère sociale et un regain de demandes politiques radicales. Lors de la présidentielle de 2016, candidats de tous bords ont fait de la concurrence chinoise une des causes majeures du malaise économique américain.
Ce déplacement des tensions économiques vers la sphère politique a favorisé des réponses gouvernementales plus autoritaires, posant la question d’une convergence, paradoxale, entre certaines pratiques américaines et le modèle non‑libéral chinois.
L’exception devenue norme : outils et pratiques
Sous l’effet de la perception d’une menace chinoise, les administrations américaines ont eu recours à des pouvoirs présidentiels étendus et parfois inédits. Les mesures prises ont inclus :
- déclarations d’état d’urgence et recours aux pouvoirs exécutifs pour justifier des actions économiques ;
- tarifs et barrières commerciales globaux, sanctions et interdictions d’exportation ;
- restrictions d’investissement et listes noires visant entreprises et individus ;
- création d’organismes ad hoc, gels et redirections de fonds, et utilisation du système judiciaire pour cibler opposants politiques et médias ;
- pressions sur institutions privées (universités, cabinets d’avocats) et pratiques de loyauté administrative.
Ces pratiques ont contribué à une évolution vers ce que certains qualifient de « démocratie référendaire » : un exécutif fort, élu, mais de plus en plus ménagé des contre‑pouvoirs juridiques et institutionnels.
Carl Schmitt : penser la politique comme conflit
Carl Schmitt, juriste et théoricien politique allemand du XXe siècle, voyait la politique comme fondamentalement antagoniste : la distinction ami‑ennemi est, selon lui, le coeur de l’action politique. Pour Schmitt, la libéralité est fragile, dépendante de périodes sans crise où le droit semble souverain.
Sa fameuse formule — « le souverain est celui qui décide de l’état d’exception » — traduit l’idée que, face à une crise perçue comme existentielle, les décideurs agissent en dehors du droit pour préserver l’ordre.
Dans ce cadre, les institutions multilatérales et juridiques (comme l’OMC) apparaissent comme des tentatives libérales pour masquer des conflits de pouvoir sous couvert d’échanges économiques. La réaction américaine récente — remise en cause des mécanismes de règlement des différends et emploi du prétexte de « sécurité nationale » — correspond à une lecture schmittienne de la politique.

Le tournant civilisationnel et la montée des antagonismes
Depuis la première demande de Robert Zoellick en 2005 — inviter la Chine à devenir un « acteur responsable » du système international — la relation a évolué vers un affrontement plus marqué.
Les États‑Unis ont progressivement décrit la Chine comme une puissance « révisionniste » menaçant l’ordre établi. Cette perception a légitimé une série de ripostes économiques, technologiques et diplomatiques visant à contenir Pékin.
Dans une grille schmittienne, l’adversaire devient « ennemi absolu » et la défense de l’identité nationale peut justifier des mesures exceptionnelles au nom de la survie politique et économique.
Une pente non irréversible, mais difficile à remonter
Les théories de Schmitt ne décrivent pas une fatalité mécanique, mais des tendances : la fragilité de la libéralité face aux crises peut engendrer des glissements autoritaires, sans que cela soit inévitable.
Fukuyama évoquait aussi le « dernier homme » — l’individu apathique d’une société de consommation — capable par son renoncement d’affaiblir la défense de la liberté libérale. De même, l’usure des institutions peut ouvrir la voie à des dirigeants qui préfèrent l’ordre à la délibération.
La restauration possible de la démocratie libérale passerait par le renforcement des liens idéologiques, sécuritaires et économiques entre les États‑Unis et leurs alliés traditionnels, ainsi que par la reconquête des institutions par des acteurs qui défendent la séparation des pouvoirs.
Toutefois, la montée des mouvements populistes et nationalistes en Europe et ailleurs rend ce redressement incertain. La séduction des solutions schmittiennes — promesses d’efficacité et d’unité face aux menaces — n’en est qu’à ses débuts en Occident.

