Les villes cherchent à concilier croissance, mobilité et bien-être, et l’urbanisme favorable à la santé (UFS) s’impose comme une approche structurante. Des chercheurs et des collectivités décrivent les principes, les outils publics et les premières réalisations qui montrent comment l’aménagement peut réduire les risques pour la santé et renforcer les protections.
\n
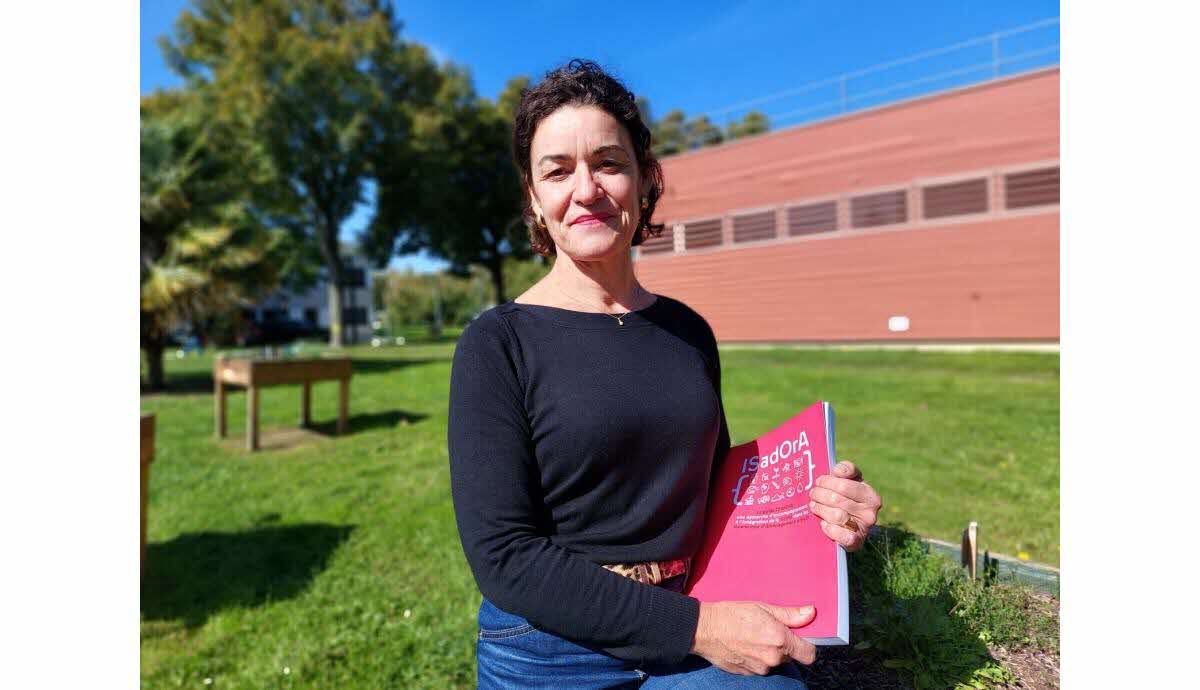 \n
\n\n
L’urbanisme favorable à la santé en France: principes et ambitions
\n
« C’est une approche par les déterminants de la santé. On en a retenu quinze. Par exemple, on regarde les polluants de l’air, de l’eau, des sols, l’exposition à des produits chimiques, à des perturbateurs endocriniens. On les croise avec des déterminants de cadre de vie comme l’exposition à la lumière, au bruit, mais aussi avec des déterminants socio-économiques comme les interactions sociales, les accès aux transports, aux espaces verts, aux commerces et services, à l’emploi. Enfin, il y a des déterminants plus individuels comme les habitudes de vie, d’alimentation, d’activité physique au quotidien.Il s’agit d’encourager des choix de politiques publiques d’aménagement qui, d’une part, minimisent l’exposition des populations à des facteurs de risque (comme les pollutions de l’air ou la sédentarité). Et qui, d’autre part, maximisent leur exposition à des facteurs de protection (comme les aménagements cyclables ou les parcs publics). Évidemment, il faut mettre les impacts sur la santé humaine en cohérence avec les impacts sur l’environnement et le climat, dans le contexte du changement climatique. L’urbanisme favorable à la santé, c’est aussi une façon de lutter contre les inégalités, l’isolement social… Il y a des co-bénéfices à aller chercher. »
\n
Selon Anne Roué-Le Gall, porte-parole du collectif Urbasept, l’approche relie santé et environnement et vise à réduire les inégalités.
\n
« J’aime bien donner l’exemple de l’activité physique, parce qu’on sait tous à peu près bien que l’activité physique, c’est bon pour notre santé. Mais notre façon de pratiquer l’activité physique ne repose pas uniquement sur notre bonne volonté. Si on veut garder une régularité dans l’activité physique, on a tout intérêt à s’appuyer sur des mobilités actives, notamment lors de déplacements domicile-travail. À condition de disposer d’infrastructures appropriées, comme des pistes cyclables sécurisées et continues, des circulations piétonnes, des connexions avec des transports en commun, etc. Ça passe donc par des aménagements urbains, périurbains ou ruraux qui permettent de faire de l’activité physique un facteur de protection, et donc de limiter au maximum ce facteur de risque pour la santé qu’est la sédentarité. »
\n
Ce point de vue illustre les liens entre mobilité et santé, mis en avant par les chercheurs et les aménageurs.
\n
« D’abord, nous essayons de les convaincre qu’ils sont, eux-mêmes, des acteurs de santé publique et que l’aménagement et l’urbanisme sont des leviers puissants d’amélioration de la santé. La santé, ce n’est pas que le soin, même si c’est un axe prioritaire et primordial. La santé, c’est le bien-être physique et mental et il dépend beaucoup de notre cadre de vie. Par exemple, on les amène à regarder et donc à organiser des espaces verts urbains comme des lieux de protection des populations face aux pollutions, au bruit, à la hausse des températures et même des inondations. Les espaces verts, ce sont aussi des lieux d’interactions sociales et d’activité physique, de ressourcement de la santé mentale et de préservation de la biodiversité. Une végétalisation de cour d’école, si c’est bien fait, c’est une entrée intéressante de ce point de vue.
\n
Des guides publics et des initiatives locales sont présentés comme des points d’appui pour aider les décideurs à passer de la théorie à la pratique.
\n
« Nous voyons aussi des initiatives encourageantes apparaître ou se concrétiser, principalement dans les aires urbaines. Je pense à Rennes Métropole qui s’efforce – même si c’est difficile –, de faire travailler ses services ensemble pour bien saisir tous les enjeux. Nous avons mené une expérimentation dans le quartier de Maurepas, à Rennes. Le pays du Mans vient d’intégrer le principe d’urbanisme favorable à la santé dans la révision de son schéma de cohérence et d’organisation territoriale. C’est aussi le cas d’autres documents d’urbanisme, comme à Miramas. On n’est pas encore à 100 projets en France ! Avec ses expérimentations Urba Santé, l’Ademe incite également à franchir le pas. »
\n
Une instance dédiée et des exemples internationaux, comme au Québec, sont évoqués comme modes de progression.
\n
« Je pense que chaque collectivité ou groupe de collectivités devrait créer une instance dédiée, avec une personne qui pilote. Au Québec, une dizaine de municipalités ont mis en place des postes de conseillers scientifiques. Ils ne sont pas spécialistes de tout, mais sur ces enjeux complexes et multifactoriels, ils vont chercher des expertises pour objectiver la planification, les décisions selon les profils de projets d’aménagement. Par ailleurs, on connaît souvent bien les profils socio-économiques des populations des territoires, il faut que l’on en saisisse mieux les profils sanitaires et environnementaux. De notre côté, on devrait recruter des économistes pour rendre plus claire une approche par les coûts évités, sur le long terme, un facteur de décision déterminant en ces temps de restrictions budgétaires. »
\n
Des outils et initiatives concrètes pour les collectivités
\n
Au sein de l’École des hautes études en santé publique, l’ouverture d’un diplôme d’établissement en santé publique et aménagement du territoire est citée comme objectif: former des acteurs relais et allier coût et formation pour toucher plus de monde, selon les responsables du programme.
\n
Des outils concrets existent: Agir pour un urbanisme favorable à la santé (2014) et ISadOrA (2020), élaborés avec une agence d’urbanisme pour guider les décideurs sans recourir à des recettes clé en main.
\n
« Nous avons déjà formé 70 personnes, pour moitié des professionnels de santé, pour moitié des aménageurs et urbanistes. Une quinzaine d’experts sont formés par an. Ils viennent quatre semaines à l’école sur quatre mois. On cherche à en faire des acteurs relais dans les régions sur ces enjeux. C’est un diplôme unique et payant, qui leur coûte 5 000 euros. Je cherche à le faire financer pour toucher plus de monde.»
\n
Cette formation est présentée comme un élément clé pour déployer l’urbanisme favorable à la santé sur tout le territoire.
\n

