Table of Contents
Des répercussions potentielles des dernières déclarations sur le paracétamol et l’autisme ont relancé le débat public, dans un contexte où des études et des prises de position officielles se confrontent. Le paracétamol est souvent présenté comme un anti‑douleur sûr, mais des travaux récents explorent ses effets potentiels pendant la grossesse et le développement de l’enfant. Dans ce cadre, les déclarations de Donald Trump et les réactions d’organisations internationales et françaises alimentent l’actualité et les débats de santé publique sur le sujet.
Des résultats contradictoires sur le lien paracétamol et autisme
La méta‑analyse publiée le 13 août 2025 dans la revue BMC Environnemental Health a épluché les données de 46 études et explique qu’« l’exposition prénatale au paracétamol pouvait augmenter le risque de troubles neurodéveloppementaux, notamment de troubles du spectre autistique et de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), chez l’enfant », lit‑on dans un communiqué. Toutefois, les auteurs précisent que ces résultats ne démontrent pas que le paracétamol provoque directement ces troubles et préconisent une utilisation prudente et limitée dans le temps.
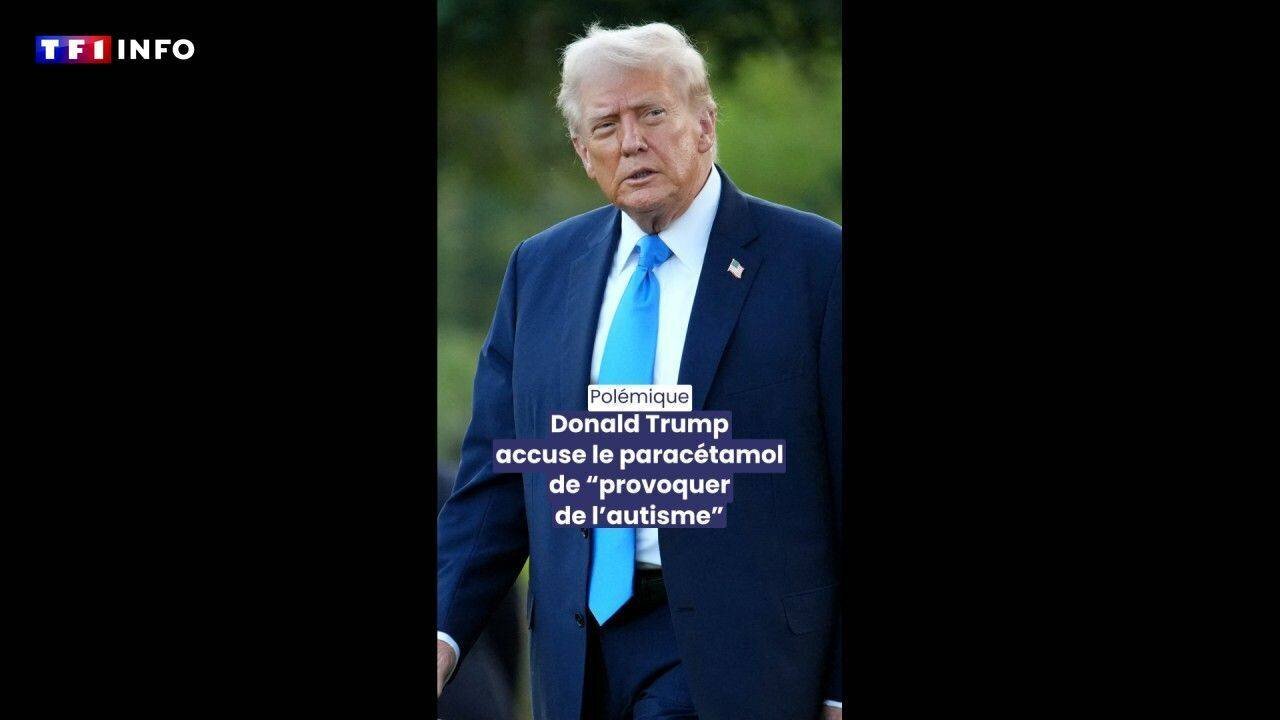
« Les femmes enceintes ne doivent pas arrêter leur traitement sans consulter leur médecin », a toutefois mis en garde le Dr Diddier Prada de l’Icahn School of Medicine. « Une douleur ou une fièvre non traitée peuvent également nuire au bébé. Notre étude souligne l’importance de discuter de l’approche la plus sûre avec les professionnels de santé et d’envisager des options non médicamenteuses chaque fois que possible. »
Des conclusions contradictoires. Mais une autre étude, de très grande ampleur, publiée en 2024, arrive à une tout autre conclusion. Les chercheurs ont analysé les données de 2,4 millions d’enfants nés en Suède entre 1995 et 2019. Ils ont ensuite étudié les près de 186 000 enfants dont les mères avaient été traitées au paracétamol pendant leur grossesse. Ces enfants ont ensuite été comparés à leurs frères et sœurs lorsque la mère n’avait pas été traitée au paracétamol pendant ses autres grossesses. « Nous n’avons constaté aucune augmentation du risque de TDAH, d’autisme ou de déficience intellectuelle chez les enfants, susceptible d’être attribuée à la prise de paracétamol pendant la grossesse », explique Renee Gardner, professeure au Département de santé publique mondiale du Karolinska Institutet (Suède) et co‑auteure de l’étude.
Cette méthode consistant à utiliser des frères et sœurs a ainsi permis aux chercheurs de contrôler de nombreux biais qui pourraient autrement fausser les résultats. « Les personnes qui prennent du paracétamol diffèrent des personnes qui n’en prennent pas, et ce de plusieurs manières (statut socio‑économique, génétique, habitudes de vie… ndlr). Ces différences sont difficiles à saisir avec les méthodes statistiques standard. En comparant les frères et sœurs, nous pouvons contrôler de nombreux facteurs », a expliqué le Pr Brian Lee, de l’Université Drexel, membre de l’AJ Drexel Autism Institute de Philadelphie, et co‑auteur de l’étude.
Des biais méthodologiques mis en cause. En France, le CRAT, Centre de référence sur les agents tératogènes, déclarait en 2024 : « les données publiées chez les femmes enceintes exposées au paracétamol sont très nombreuses, quel que soit le terme de la grossesse, et aucun effet malformatif, fœtal ou néonatal attribuable au traitement n’est retenu à ce jour ». Concernant les études qui établissaient un lien entre l’anti‑douleur et le risque d’autisme, le centre pointe des biais méthodologiques de ces études qui ne permettent pas de retenir ces associations. Il ajoutait toutefois qu’une utilisation du paracétamol à la posologie minimum efficace et pour la durée la plus brève possible est toujours préférable.
Aux États‑Unis, de nombreux experts ont réagi après la sortie de Donald Trump, dont l’Association américaine des obstétriciens‑gynécologues. « L’annonce faite aujourd’hui par le département de la Santé et des Services sociaux n’est pas étayée par l’ensemble des preuves scientifiques et simplifie dangereusement les causes nombreuses et complexes des troubles neurologiques chez les enfants. (…) Les études souvent citées comme preuves d’un lien de causalité, y compris la dernière revue systématique publiée en août, présentent les mêmes limites méthodologiques que la plupart des études sur ce sujet, notamment l’absence de contrôle des facteurs de confusion ou l’utilisation de données autodéclarées peu fiables », ajoute l’association. En effet, si les mères prennent du paracétamol, il est légitime de se demander pourquoi elles en prennent et si elles ne présentent pas de problèmes de santé sous‑jacents qui pourraient être des facteurs de risque.
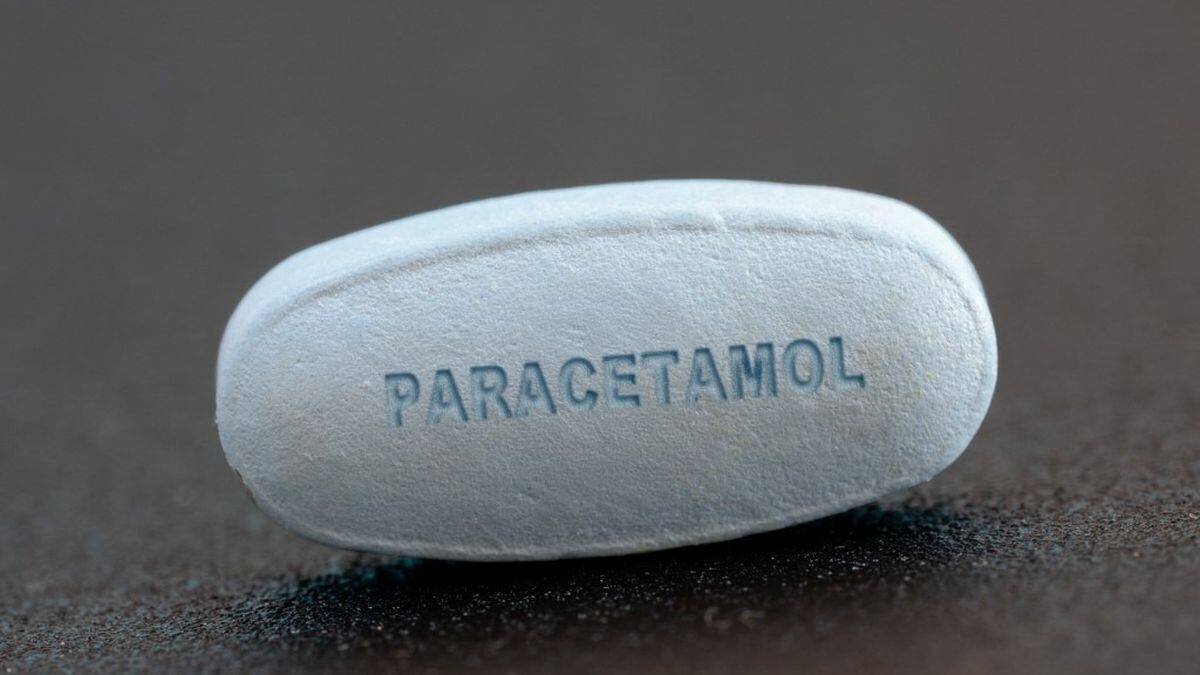
Réactions et mises en garde des autorités et associations
En France, le CRAT déclare en 2024 que « les données publiées chez les femmes enceintes exposées au paracétamol sont très nombreuses, quel que soit le terme de la grossesse, et aucun effet malformatif, fœtal ou néonatal attribuable au traitement n’est retenu à ce jour ». Il pointe aussi des biais méthodologiques et recommande une posologie minimale et une durée la plus brève possible.
« les données publiées chez les femmes enceintes exposées au paracétamol sont très nombreuses, quel que soit le terme de la grossesse, et aucun effet malformatif, fœtal ou néonatal attribuable au traitement n’est retenu à ce jour ». Concernant les études qui établissaient un lien entre l’anti‑douleur et le risque d’autisme, le centre pointe des biais méthodologiques de ces études qui ne permettent pas de retenir ces associations. Il ajoutait toutefois qu’une utilisation du paracétamol à la posologie minimum efficace et pour la durée la plus brève possible est toujours préférable.
Aux États‑Unis, l’Association américaine des obstétriciens‑gynécologues affirme que « L’annonce faite aujourd’hui par le département de la Santé et des Services sociaux n’est pas étayée par l’ensemble des preuves scientifiques et simplifie dangereusement les causes nombreuses et complexes des troubles neurologiques chez les enfants. … Les études souvent citées comme preuves de causalité, y compris la dernière revue systématique publiée en août, présentent les mêmes limites méthodologiques que la plupart des études sur ce sujet, notamment l’absence de contrôle des facteurs de confusion ou l’utilisation de données autodéclarées peu fiables ».
« Les vaccins ne causent pas l’autisme », rappelle l’OMS, tout en appelant à suivre les recommandations sanitaires et à ne pas retarder les calendriers de vaccination.
Du côté international, l’Organisation mondiale de la Santé rappelle que « certaines études d’observation ont suggéré une possible association entre l’exposition prénatale au paracétamol et l’autisme, mais les preuves restent incohérentes ». Elle insiste aussi sur le fait que « les vaccins ne causent pas l’autisme » et que retarder les calendriers peut augmenter le risque d’infection.
Position des organisations internationales et conseils pratiques
Face à ces divergences, les autorités recommandent une posologie minimale efficace et un dialogue avec un médecin, notamment pendant la grossesse. Le consensus porte sur la prudence et sur l’évaluation des besoins réels, en pesant bénéfices et risques et en envisageant des alternatives non médicamenteuses lorsque cela est possible.

