En France, l’agence sanitaire Anses publie un état des lieux sur les PFAS, ces substances perfluoroalkylées auxquelles on attribue des effets persistants. L’étude analyse près de 2 millions de données couvrant 142 PFAS différents et différentes matrices telles que l’eau potable, les aliments, l’air et les sols, ainsi que les poussières et les échantillons biologiques humains. Malgré des niveaux moyens dans le sang de la population inférieurs aux seuils existants et comparables à l’Europe, des zones d’ombre subsistent, notamment concernant l’exposition professionnelle. L’Anses propose une méthode de catégorisation des PFAS et recommande une stratégie de surveillance en trois axes, tout en appelant à étudier d’autres sources potentielles de contamination.
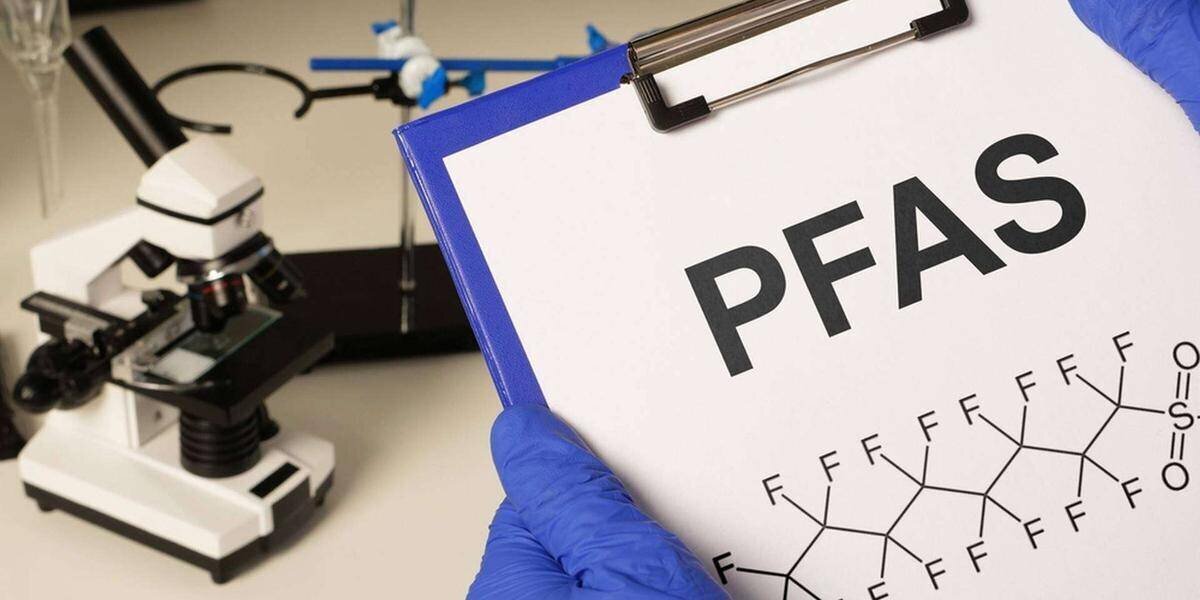
Trois axes de surveillance préconisés par l’Anses
Selon l’agence, la surveillance des PFAS doit reposer sur trois volets complémentaires, à intégrer dans les plans nationaux et locaux. Une surveillance pérenne vise les substances les plus préoccupantes et récurrentes; une surveillance exploratoire porte sur les substances insuffisamment recherchées aujourd’hui; une surveillance localisée s’applique aux contaminations locales avérées ou suspectées, anciennes ou actuelles.
- Une surveillance pérenne: pour les substances les plus préoccupantes et récurrentes, à intégrer dans les plans de surveillance nationaux.
- Une surveillance exploratoire: pour les substances insuffisamment recherchées aujourd’hui.
- Une surveillance localisée: pour les substances liées à des contaminations locales avérées ou suspectées, qu’elles soient anciennes ou actuelles.
L’agence rappelle également l’urgence d’étudier d’autres sources potentielles de contamination : les matériaux au contact des aliments et de l’eau, les matériaux de construction et divers produits de consommation. Elle recommande tout particulièrement d’évaluer le potentiel de relargage ou d’émission de PFAS à partir de ces produits et matériaux.
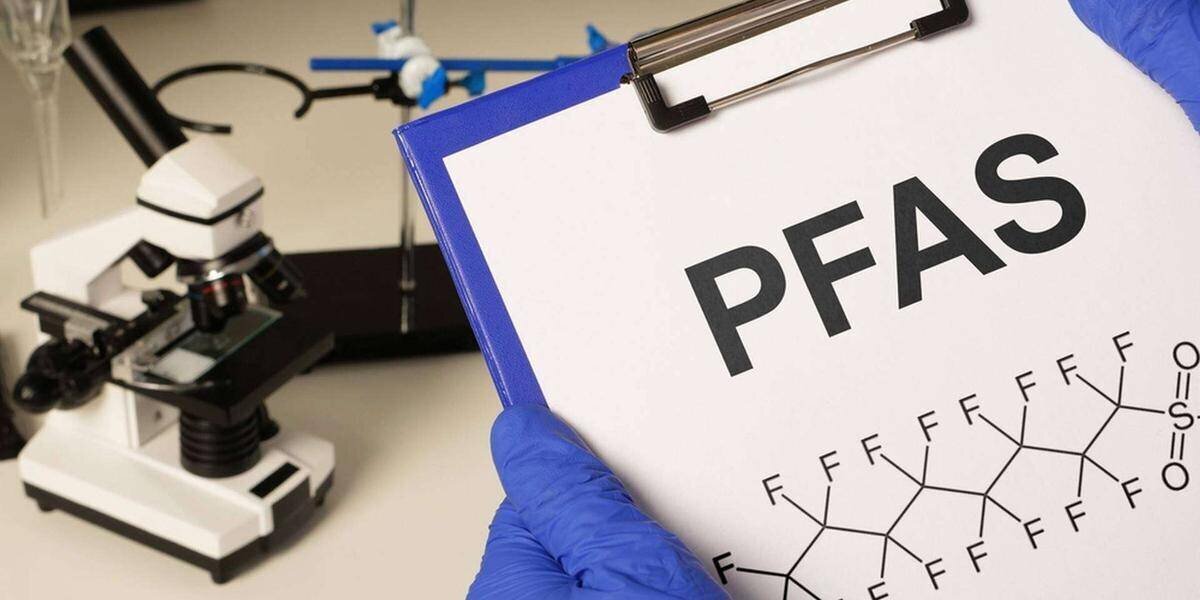
Vers une approche globale des contaminants chimiques
Au-delà des PFAS, l’Anses rappelle que d’autres substances persistantes comme les dioxines, les PCB (polychlorobiphényles), les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ou les métaux lourds nécessitent également une surveillance sanitaire. L’agence plaide pour une approche globale de la surveillance des contaminants chimiques.
Cette démarche vise à mieux prévenir les expositions et à guider les décisions publiques dans les années à venir.

