Table of Contents
Le 24 juillet 2025, un décret exécutif américain intitulé « Mettre fin à la criminalité et au désordre dans les rues américaines » a relancé un débat inquiétant : la réactivation des détentions forcées de personnes sans abri au prétexte de dépendance ou de maladie mentale. Cette mesure interroge la frontière entre autorité politique et pouvoir psychiatrique, et rappelle comment le discours médical peut servir d’outil de contrôle social, en occultant les causes sociales et économiques telles que la pauvreté, la crise du logement et les défaillances des systèmes de soins.
Lire aussi :
- غرام بعض الناس باليمين والفاشية يفسره علم النفس — https://www.aljazeera.net/sukoon/2025/4/19/%d9%84%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%8a%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%85
- طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟ — https://www.aljazeera.net/sukoon/2025/7/19/%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%8a%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%85-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-140
Ce contexte contemporain fait resurgir les questions soulevées par le psychiatre et penseur Thomas Szasz, qui a longtemps remis en cause le statut médical de la « maladie mentale » et a dénoncé l’usage politique de la psychiatrie pour isoler et contrôler les marginalisés.

« La maladie mentale est un mythe dont la fonction est de masquer l’amertume des conflits moraux dans les relations humaines. » — Thomas Szasz
Naissance dans l’ombre de la répression
Thomas Stephen Szasz naît le 15 avril 1920 à Budapest, dans une famille juive de classe moyenne. Son enfance se déroule dans une Europe marquée par la montée des nationalismes et des exclusions, un contexte qui forge très tôt son sens aigu de l’injustice.
À 18 ans, confrontée à la montée des périls en Europe, sa famille émigre aux États-Unis : un changement géographique qui l’exposera à d’autres formes de tensions sociales, mais qui lui ouvrira aussi le chemin d’une formation scientifique et médicale.
Ces expériences d’exclusion et de migration alimenteront plus tard sa critique du rôle social et politique de la psychiatrie.
Parcours académique et basculement intellectuel
Installé à Cincinnati, Szasz étudie la physique à l’université de Cincinnati et en sort diplômé avec mentions en 1941. Insatisfait par la seule approche physique, il se tourne vers la médecine.
Après des refus répétés de facultés de médecine — épreuve aussi marquée par des discriminations liées à son identité — il est finalement admis à la faculté de médecine de Cincinnati et obtient son diplôme en 1944, en tête de promotion.
Il entame ensuite une carrière en psychanalyse à l’Institut de Chicago avant de rejoindre l’État de New York comme professeur de psychiatrie au « Upstate Medical Center ». Malgré sa réussite professionnelle, Szasz conserve des doutes profonds sur les fondements mêmes de la discipline qu’il enseigne.
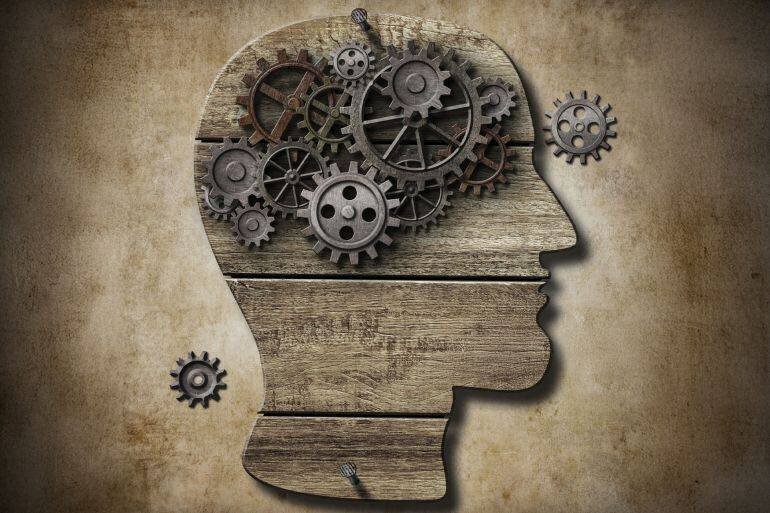
Il comparera plus tard son parcours à celui d’un athée qui étudie la théologie, illustrant le conflit intérieur entre sa pratique et ses convictions philosophiques.
Briser le mythe : la maladie mentale comme métaphore linguistique
La rupture publique de Szasz intervient en 1960 avec un article dans American Psychologist, qui anticipe la publication l’année suivante de son ouvrage majeur, The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct.
Pour Szasz, l’expression « maladie mentale » relève d’une métaphore, non d’une entité médicale mesurable. Il écrit que la notion sert à dissimuler des conflits moraux et à rendre socialement acceptables des réactions qui, autrement, seraient jugées moralement reprochables.
Sa thèse centrale est la suivante : contrairement aux organes comme le cœur ou le poumon, il n’existe pas d’organe identifiable nommé « l’esprit », et l’idée d’une pathologie mentale biologique est donc conceptuellement trompeuse.
Pour approfondir ce texte fondateur : https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0046535
Des inquisitions aux institutions psychiatriques
Dans The Manufacture of Madness (1970), Szasz établit un parallèle provocateur entre les institutions psychiatriques modernes et les tribunaux d’inquisition médiévaux. Il considère la psychiatrie comme un substitut séculier au pouvoir religieux, offrant une promesse de « rédemption » mais manquant d’objectivité.
Selon lui, l’étiquetage en « fou » ou « malade mental » permet d’isoler et de déposséder des individus jugés socialement indésirables, sous couvert de soin. La psychiatrie devient ainsi un instrument de contrôle social plus que de guérison.
Pour consulter l’ouvrage cité : https://archive.org/details/manufactureofmad0000szas_i9m5/page/n5/mode/2up
De l’académie à la sphère publique
Szasz ne se limite pas aux débats universitaires : il écrit pour la presse générale, intervient dans des campagnes juridiques et milite pour restreindre les pratiques d’hospitalisation et de traitement forcés.
Il s’oppose fermement au traitement psychiatrique imposé sans consentement et défend la responsabilité individuelle face aux actes commis, y compris dans des moments de grande détresse psychique.
Son engagement public suscite des réactions vives ; certains collègues l’accusent d’excès, voire de pathologie, tandis que d’autres voient en lui un défenseur courageux des libertés civiles.

La mémoire de figures comme Ignaz Semmelweis — ridiculisé par ses pairs malgré l’importance de ses découvertes — hante la réflexion de Szasz sur la manière dont les institutions traitent les voix dissidentes.
Quel impact sur la psychiatrie américaine ?
Les idées de Szasz ont contribué à un mouvement plus large qui, dans les années 1970, a entraîné des décisions judiciaires limitant l’usage de l’hospitalisation forcée.
- Lessard v. Schmidt (1972) — restriction des pouvoirs d’internement.
- Donaldson v. O’Connor (1975) — l’internement psychiatrique doit reposer sur une menace réelle pour soi ou autrui.
- Décisions ultérieures (années 1970) — affirmation du droit des patients à refuser le traitement forcé.
Ces évolutions juridiques s’alignent partiellement sur la philosophie de Szasz et ont déplacé le débat vers des principes de liberté individuelle et de protection des droits des patients.
La psychiatrie reprend de l’autorité
À partir des années 1980, un renversement se produit : la psychiatrie se réorganise sur des bases biologiques et génétiques, soutenue par des progrès en imagerie cérébrale et par d’importants investissements de l’industrie pharmaceutique.
La parution du DSM-III en 1980 et sa logique de codification des troubles facilitent la facturation par les assurances et encouragent l’élargissement des catégories diagnostiques.
Cette médicalisation accrue a suscité des critiques portant sur la réduction de l’expérience humaine à des codes et sur les conflits d’intérêts possibles entre experts et laboratoires pharmaceutiques.
Sauvetage ou naufrage ? Les débats contemporains
La portée des critiques de Szasz reste controversée. Ses détracteurs estiment qu’une négation stricte de l’existence des troubles mentaux biologiques peut priver certains patients des soins nécessaires.
Des auteurs comme Robert E. Kendell et Edward Shorter ont souligné les limites d’une définition purement organique ou, inversement, d’un réductionnisme absolutiste qui négligerait la complexité clinique.
Pourtant, même ses opposants reconnaissent l’importance politique et éthique des questions que Szasz a posées : qui décide de la normalité ? Quels sont les risques d’un usage abîmant de la psychiatrie par des pouvoirs extérieurs ?
Thomas Szasz est décédé en septembre 2012 à l’âge de 92 ans, mettant fin à une vie intellectuelle marquée par la défense acharnée de la liberté individuelle, y compris son choix final de mettre fin à ses jours lorsqu’il l’a estimé voulu et librement choisi.
Les interrogations qu’il a soulevées demeurent d’actualité : où commence la protection et où commence la coercition ? Quand la psychiatrie sauve-t-elle, et quand devient-elle un instrument de contrôle social ?
Informations pratiques
Mot-clé principal : Thomas Szasz maladie mentale
Tags suggérés : Thomas Szasz, maladie mentale, psychiatrie, liberté individuelle, États-Unis, histoire de la psychiatrie, critique sociale, santé mentale, Hongrie

