Table of Contents
Roberto Clemente, avocat au caractère singulier, perçoit ses clients sous une forme animale, les imaginant tour à tour cochons, girafes ou singes. Pour lui-même, il s’identifie à un musicien du XIXe siècle, évoqué par ses favoris naissants et ses vêtements ajustés qui lui vont à merveille. Talentueux dessinateur, il laisse parfois tomber sa réserve, presque maladive, pour partager avec ses amis des caricatures esquissées au crayon lors des audiences ou pendant ses rares moments de flânerie, notamment au port où il prend son petit-déjeuner ou déjeune sous l’ombre des gigantesques navires amarrés.
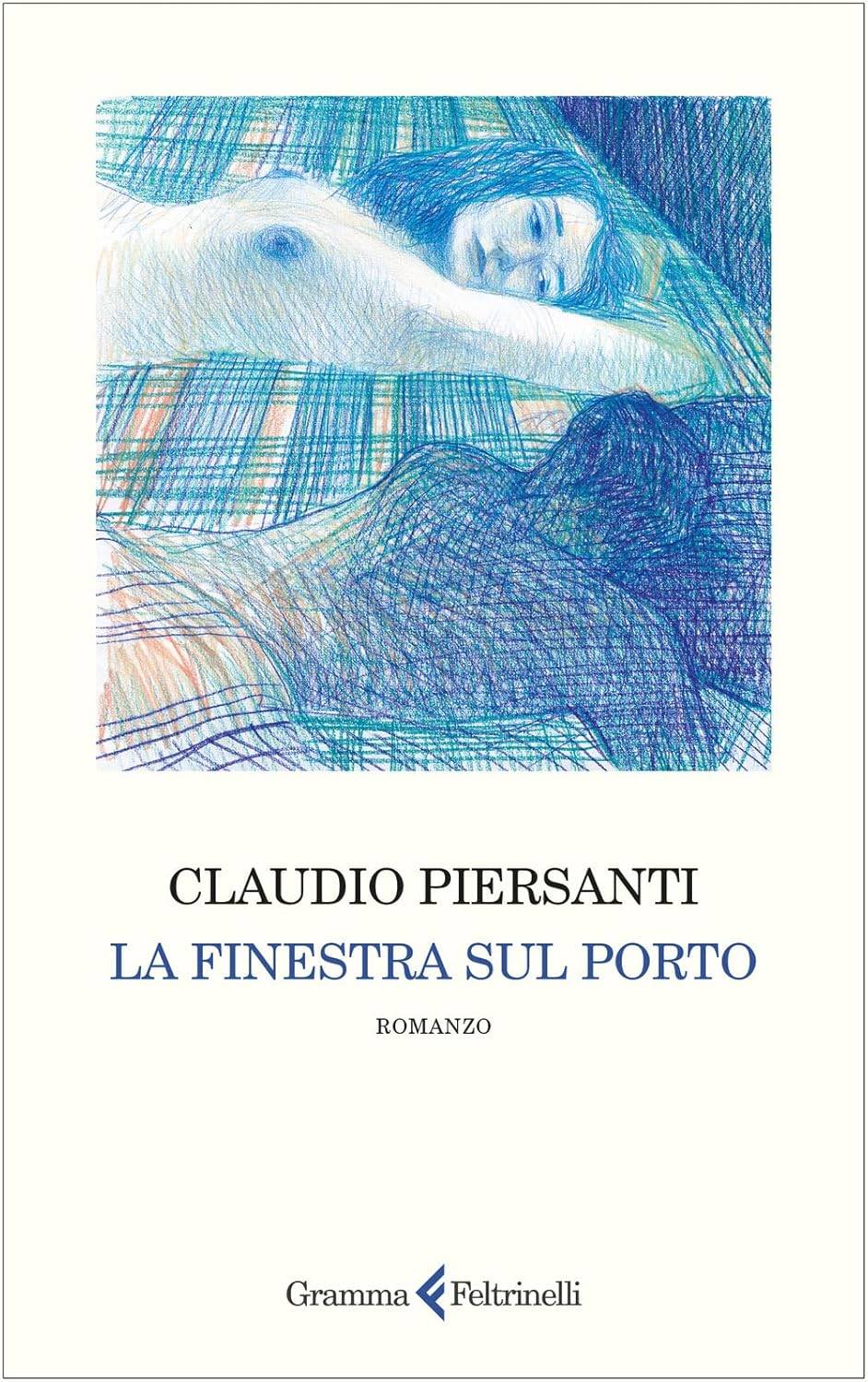
Cette misanthropie trouve ses racines à l’université, sous la tutelle d’un professeur marginal qui connaissait Kant, Hegel et Altiero Spinelli, figures intellectuelles des exclus de Ventotene. Roberto se plaît à répéter le mantra gobettien décrivant un pays « né de travers », marqué par la perte de la raison et de la sagesse. Cette vision semble être l’expression sublimée d’une enfance douloureuse : un père écrivain passionné de rock et de motos, décédé à trente ans dans un accident, et une mère infirmière disparue prématurément, qui lui a laissé en héritage un petit appartement au cœur du dédale de ruelles de la vieille ville escarpée. Ce décor est au centre du dernier roman de Claudio Piersanti, « La fenêtre sur le port » (Feltrinelli, 160 pages, 17 euros).
Une vie bouleversée par la réalité
Dans ce roman, un moment fort bascule soudainement le protagoniste dans la vie réelle : un coup de canon sonore suit une bagarre à laquelle il assiste sur un quai, où un homme se retrouve avec le nez cassé et des égratignures profondes. Cette scène, offerte par un couple débarqué d’un bateau de croisière, est un spectacle gratuit et déprimant qui marque un tournant dans l’intrigue.
Le drame personnel et ses répercussions
Le véritable bouleversement survient lorsque Maria, archéologue secrètement aimée par Roberto, doit faire face à la démence progressive de son mari Piero, qui est aussi le meilleur ami de l’avocat. L’auteur, Claudio Piersanti, excelle dans l’exploration des sentiments profonds – amour, culpabilité, honte, espoir – qui envahissent ses personnages. La gestion de la tragédie dans un contexte bourgeois, où celle-ci est niée tout en prospérant sur ce déni, devient une épreuve incessante, comparable au travail de Sisyphe, à laquelle Piersanti ne se dérobe pas.
Le charme et la complexité du roman
Ce qui fascine dans l’œuvre de Piersanti, c’est que la tragédie, bien que digérée, plane constamment, laissant le lecteur dans une inquiétude permanente quant à la possibilité même du bonheur. L’originalité ne réside pas dans les détails, plutôt naturalistes, mais dans la structure narrative globale, librement déformée et sabotée, ainsi que dans des thèmes inquiétants dissimulés dans les angles morts de l’intrigue.
L’idylle entre Roberto et Maria, par exemple, ne constitue pas un simple épisode : elle s’étend sur la moitié de l’histoire, suscitant le doute sur sa vraisemblance. Ce sentiment d’irréalité est accentué par :
- l’élitisme maîtrisé du protagoniste,
- les traits animaux attribués aux « autres »,
- les liens œdipiens entre Maria et la mère de Roberto,
- le fatalisme sans lequel cette nouvelle relation ne pourrait naître,
- et même la mer, élément vital et joyeux contenant ses propres abîmes.

