Table of Contents
La recherche scientifique constitue un pilier essentiel du progrès des sociétés humaines. Toutefois, une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Université Northwestern aux États-Unis révèle une menace croissante : la fraude scientifique organisée. Ce phénomène dangereux, présenté dans la revue « PNAS », dépasse désormais les simples cas isolés de falsification de données ou de plagiat. Il s’agit de réseaux structurés qui produisent et diffusent massivement des recherches falsifiées, motivés par des gains financiers et les fortes pressions académiques auxquelles sont soumis les chercheurs.

Les contraintes académiques figurent parmi les causes majeures de ce nouveau fléau, amplifiant la nécessité de publier constamment.
Comprendre la fraude scientifique
La fraude scientifique se définit comme la falsification délibérée de contenus scientifiques dans le but de tromper lecteurs, institutions ou pairs. Elle prend diverses formes :
- Manipulation de données ou d’images graphiques.
- Plagiat ou vol de propriété intellectuelle.
- Ajout de noms d’auteurs n’ayant pas participé à l’étude.
Par ailleurs, l’usage de l’intelligence artificielle pour générer de faux articles scientifiques se répand, ainsi que la publication dans des revues peu fiables ou corrompues. Un aspect notable est le recours aux « fermes de papiers » : des entreprises qui vendent des articles scientifiques prêts à l’emploi aux chercheurs, étudiants ou professeurs souhaitant répondre rapidement aux exigences académiques sans mener de véritables recherches.
Ces articles contiennent souvent des données fabriquées ou falsifiées, utilisent un langage étrange et répétitif, associent des auteurs sans lien réel avec le sujet, et sont publiés dans des revues obscures ou frauduleuses.
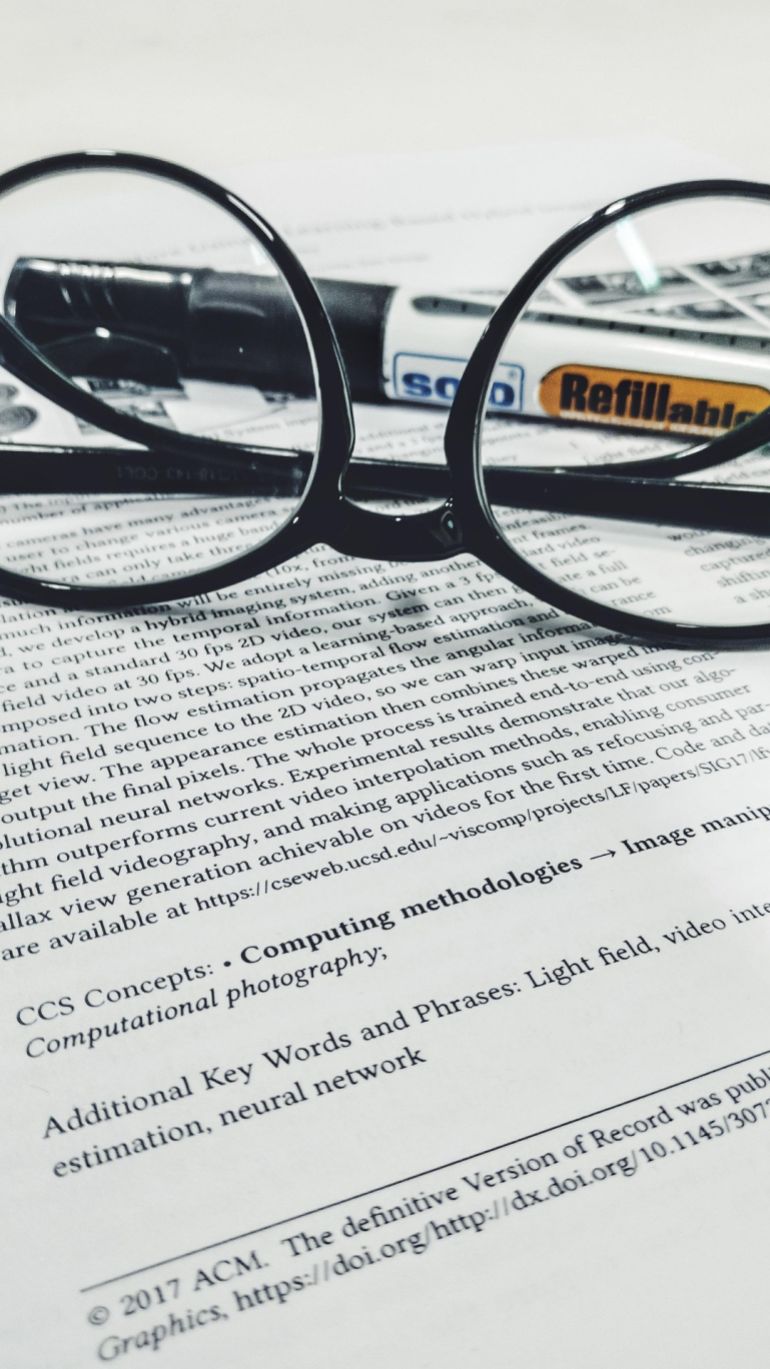
Une criminalité organisée en pleine expansion
Le caractère alarmant est l’évolution récente vers une fraude organisée semblable à un crime en réseau, avec des opérations coordonnées à l’échelle internationale, impliquant plusieurs institutions et revues scientifiques.
Les chercheurs de Northwestern ont analysé grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning plus de 10 millions d’articles publiés. Ils ont détecté des milliers d’articles présentant des schémas statistiques anormaux dans les citations, les titres et contenus, ainsi que des liens douteux entre groupes de chercheurs et maisons d’édition associées à la fraude.
La fraude scientifique croît plus rapidement que la production d’articles authentiques, ce qui constitue un avertissement majeur pour la communauté scientifique afin d’agir avant que la confiance du public ne soit irrémédiablement érodée.
Les enjeux cruciaux
Le professeur Louis A. N. Amaral, principal auteur de l’étude, souligne l’urgence d’une meilleure auto-surveillance pour préserver l’intégrité scientifique. Il met en garde :
- Le risque d’une banalisation progressive de la fraude si le phénomène n’est pas combattu.
- La possible contamination totale de la littérature scientifique.
- La nécessité de défendre la science face aux acteurs malveillants et d’en prendre pleinement conscience.

Les stratégies des réseaux frauduleux
Selon l’étude, ces réseaux emploient des méthodes bien rodées :
- Collaboration entre groupes de chercheurs pour diffuser des articles faux à travers diverses revues. Ces articles sont souvent retirés après détection, mais le mal est fait.
- Utilisation d’intermédiaires facilitant la publication collective frauduleuse en écrivant ou en publiant les articles contre paiement, voire en ajoutant des auteurs fictifs.
- Ciblage de disciplines scientifiques vulnérables, notamment certaines branches de la médecine et de la biochimie, souvent dans des revues à faible contrôle éditorial.
- Évitement des sanctions en migrant vers de nouvelles revues ou en reprenant des revues abandonnées.
- Détournement de revues respectées qui ont cessé leurs activités, par exemple en usurpant leur nom ou en créant des sites imitant ceux d’origine pour publier des faux articles.
Les pressions académiques au cœur du problème
La principale cause de ce phénomène est liée aux pressions intenses subies par les chercheurs. Ces derniers, ainsi que les étudiants en doctorat, doivent publier un certain nombre d’articles pour progresser dans leur carrière ou obtenir des financements.
Cette quête volume a conduit à un système d’évaluation qui privilégie la quantité à la qualité, encourageant parfois les pratiques malhonnêtes. Certaines universités imposent même la publication d’un article avant la soutenance, poussant les étudiants à recourir à la fraude sous la pression.
De plus, des revues peu scrupuleuses multiplient les publications rapides sans contrôle strict, profitant d’un marché lucratif où des faux articles peuvent être vendus entre 500 et 5000 dollars.
Protéger la science pour garantir la confiance
Les chercheurs alertent sur les conséquences graves de cette fraude :
- Érosion de la confiance dans la recherche scientifique, surtout si les articles falsifiés sont cités par des travaux authentiques.
- Gaspillage des ressources financières et humaines investies dans des projets basés sur de fausses données.
- Désinformation des intelligences artificielles entraînées sur des bases contaminées, affectant la qualité des connaissances produites.
- Impact direct sur la santé publique et les décisions politiques dans des domaines sensibles comme la médecine, l’environnement ou le climat.
Pour contrer ce fléau, plusieurs mesures sont proposées :
- Développer des outils d’intelligence artificielle dédiés à la détection des fraudes.
- Renforcer les procédures d’audit et de vérification dans les revues scientifiques.
- Instaurer des sanctions pour les auteurs et institutions impliquées dans la fraude.
- Adopter la transparence totale sur les données et résultats de recherche.
- Soutenir les initiatives communautaires telles que « PubPeer » et « Retraction Watch » pour le suivi post-publication.
Le professeur Amaral confie que cette étude est l’une des plus décourageantes auxquelles il ait participé. Malgré cela, il reste convaincu que la défense de la science est cruciale pour le bien de l’humanité.
La lutte contre la fraude scientifique organisée est essentielle non seulement pour préserver la réputation des chercheurs, mais également pour protéger les sociétés, les politiques publiques, et la santé mondiale.

