Table of Contents
Dans un entretien approfondi, le penseur libanais Khalālid Ziyāda examine les obstacles qui freinent la modernité arabe et questionne la relation complexe entre héritage, religion et pouvoir. Il appelle à la formation d’un courant critique capable d’élaborer une vision politique et culturelle nouvelle, au-delà d’une simple imitation des modèles européens.
Portrait et parcours
Khalālid Ziyāda est titulaire d’un doctorat de la Sorbonne et a enseigné à l’Institut des sciences sociales de l’Université libanaise. Il a cumulé expérience académique et diplomatique, ayant servi comme ambassadeur du Liban en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue arabe.
Directeur de la branche de Beyrouth du Centre arabe de recherches et d’études politiques, Ziyāda a publié de nombreux ouvrages sur la modernité, l’histoire ottomane et les relations entre Orient et Occident, dont « Les musulmans et la modernité européenne » et « La ville arabe et la modernité ».

Peut-on atteindre une véritable renaissance dans le monde arabe ?
Ziyāda juge la situation actuelle difficile mais refuse le pessimisme absolu : une renaissance reste possible si l’on crée des conditions politiques et sociales favorables.
Il identifie comme priorités :
- la liberté d’expression et le pluralisme politique ;
- l’écoute des opinions diverses et le respect de la pluralité intellectuelle ;
- la formation de dirigeants intermédiaires capables d’assurer la continuité politique.
Selon lui, les soulèvements depuis 2011 ont montré l’absence de leadership intermédiaire durable et le manque de programmes clairs, ce qui a entravé l’émergence d’alternatives politiques stables.
Europe : un épuisement des grandes idées, nécessité d’un projet arabe
Dans son livre « Il n’y a plus rien à offrir à l’Orient », Ziyāda soutient que l’Europe n’est plus la source des « idées majeures » comme elle l’a été depuis la Révolution française.
Il rappelle que les grandes doctrines du XXe siècle (nationalisme, socialisme, communisme) se sont affaiblies, laissant place à des approches critiques et académiques plutôt qu’à des projets de transformation sociétale.
Conséquence : les pays arabes doivent produire leurs propres cadres conceptuels. Pour cela, il faut :
- un environnement de liberté intellectuelle ;
- une vie politique et syndicale active ;
- une critique systématique des expériences passées pour élaborer de nouvelles propositions.
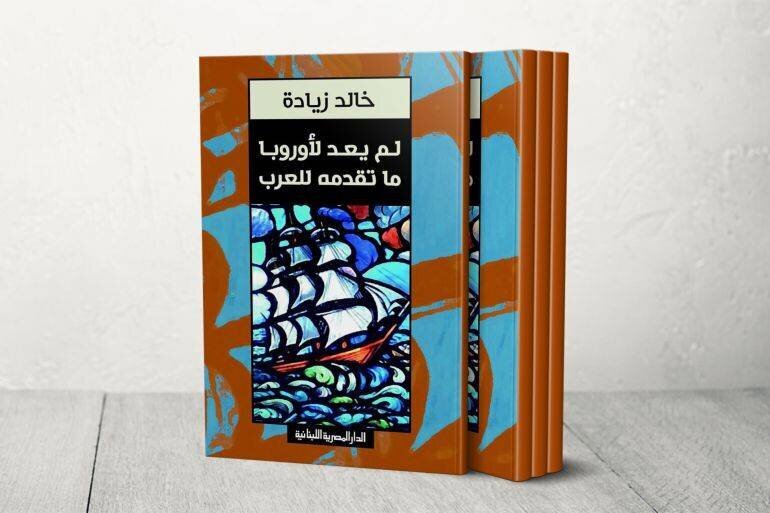
Pourquoi la modernité arabe bute-t-elle sur son héritage ?
Ziyāda souligne que le problème n’est pas seulement d’imiter la forme de la modernité, mais d’en produire le sens local. Le rapport au patrimoine religieux et intellectuel reste mal révisé.
Il distingue deux enjeux :
- changer la manière de regarder le patrimoine sans le renier ;
- réformer les institutions religieuses pour clarifier la relation entre foi individuelle et structures institutionnelles.
Tant que le débat public alterne entre positionnements antagonistes—accompagnés parfois d’accusations d’apostasie ou de trahison—la possibilité d’un consensus réformateur demeure faible.
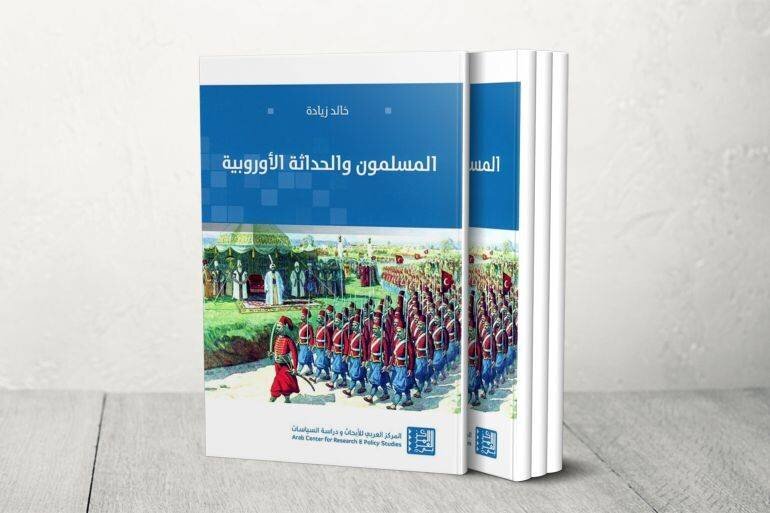
L’État, le religieux et la question de l’autorité
En revenant à l’histoire réformatrice, Ziyāda évoque l’œuvre de Muhammad Abduh et l’idée de libérer le croyant de la domination institutionnelle. Cette impulsion n’a pas été consolidée.
Il explique que l’État moderne a souvent accaparé la religion, créant un système où l’institution religieuse est contrôlée politiquement plutôt que d’être une force d’émancipation morale.
Pour sortir de cette impasse, il appelle à la construction d’un courant critique collectif, capable d’écarter les querelles idéologiques stériles et de penser la modernité arabe de façon méthodique.
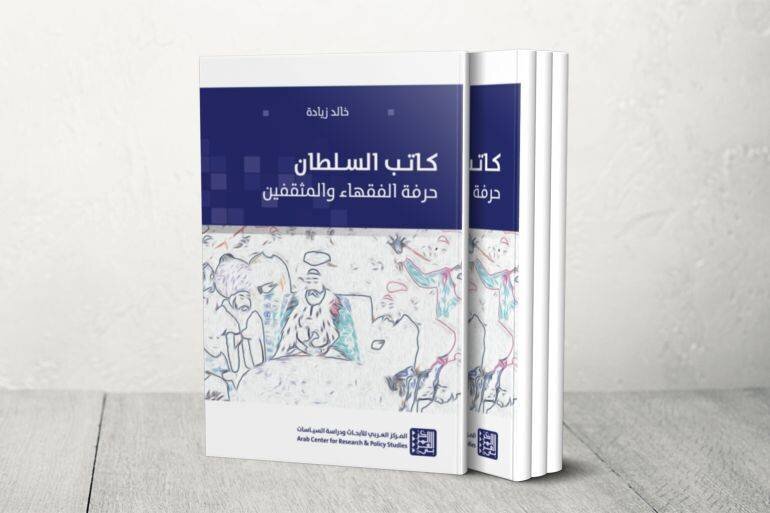
La marginalisation du critique après l’indépendance
Ziyāda retrace comment, après l’indépendance, l’État national a progressivement réduit l’espace du penseur critique. Les élites culturelles ont été cooptées ou muselées, tandis que l’État consolidait ses propres institutions.
Autre conséquence : la disparition d’un espace public réellement influent pour formuler des alternatives viables. Le rôle du « métier » du savant s’est transformé en fonction d’un État centralisé qui s’estime suffisant pour gouverner.
Les révoltes de 2011 : un réveil sans leadership intellectuel
Les soulèvements populaires ont souvent été spontanés et portés par des générations jeunes. Ziyāda regrette l’absence d’une avant-garde intellectuelle capable d’articuler des programmes clairs et de canaliser les mobilisations vers des objectifs durables.
Il prend l’exemple du Liban en 2019 : une mobilisation populaire massive mais fragmentée, portée par des centaines d’associations sans unité programmatique, ce qui a limité son impact à long terme.
Démocratie : force structurante malgré ses limites
Face à la critique de l’Occident, Ziyāda défend l’idée que, malgré ses défauts, la démocratie occidentale a produit des acquis institutionnels tangibles : État de droit, indépendance judiciaire et mécanismes de reddition de comptes.
Il estime que l’objectif prioritaire n’est pas d’importer un modèle parfait, mais de construire :
- la primauté du droit ;
- la liberté d’expression ;
- le transfert pacifique du pouvoir.
Ces bases sont, selon lui, préalables à toute modernité arabe durable.
Pourquoi l’État moderne tarde-t-il à émerger ?
Ziyāda identifie des racines historiques profondes, qu’il relie à une continuité d’éléments du pouvoir de type « mamelouk » : une autorité séparée des populations, persistante malgré les formes républicaines.
À cela s’ajoutent des disparités structurelles : villages gouvernés par des coutumes tribales, sociétés agricoles marquées par des relations quasi-féodales, et villes plus modernes. Ces fractures rendent difficile la formation d’un citoyen uniforme et d’un État moderne cohérent.
Le dialogue entre le Machreq et le Maghreb
Ziyāda observe un déséquilibre historique : le Maghreb a souvent regardé vers le Machreq, mais l’inverse était moins fréquent. Depuis les années 1970, cependant, la pensée marocaine et maghrébine a pris une importance accrue dans le monde arabe.
Il souligne que le Maghreb a, en grande partie, évité les effusions idéologiques qui ont affaibli le Machreq. Cela a permis l’émergence d’un débat intellectuel plus productif et moins polarisé.
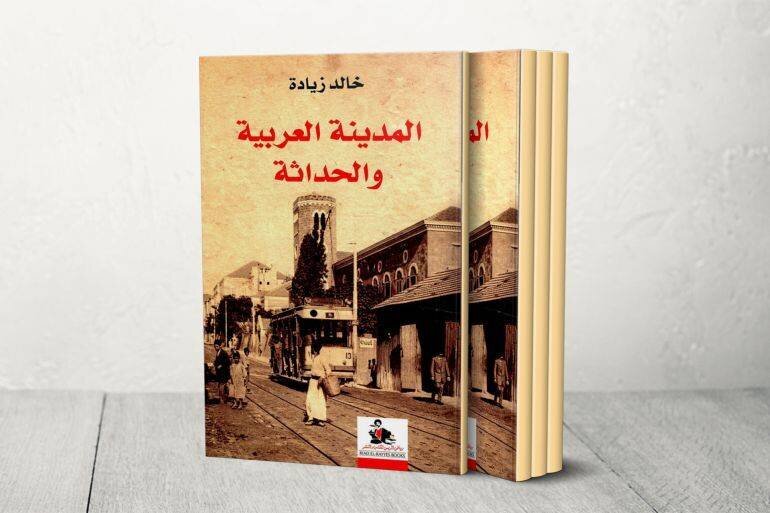
Vers un courant critique arabe
Ziyāda conclut en appelant les intellectuels arabes à rompre avec les querelles stériles et à fonder un courant critique collectif. Ce courant devrait :
- produire des analyses rigoureuses des expériences passées ;
- proposer des programmes politiques et institutionnels concrets ;
- défendre la pluralité, la démocratie et la primauté du droit.
Sans cette initiative, la modernité arabe restera largement formelle : bâtiments, parlements et symboles sans les pratiques profondes qui font vivre une société démocratique.
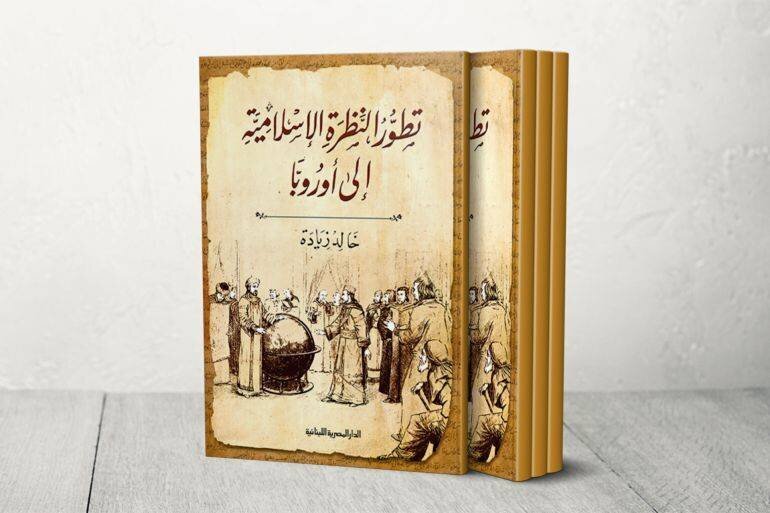
Pour Khalālid Ziyāda, la construction d’une modernité arabe authentique exige un travail patient et collectif : une révision critique de l’héritage, la consolidation de l’État de droit, l’émancipation des institutions religieuses de la tutelle politique et l’émergence d’un courant intellectuel capable d’élaborer des projets concrets pour notre temps.

