Table of Contents
Le manque d’une définition unanime du journalisme d’investigation suscite un large débat : certains chercheurs y voient un simple prolongement du journalisme traditionnel, tandis que d’autres y reconnaissent une proximité avec la recherche scientifique en raison de son recours à des règles strictes, à des outils de vérification et à une visée de documentation rigoureuse.
Sur cette problématique, le Centre Al Jazeera d’études a publié une étude intitulée « Le travail scientifique dans l’investigation : s’inspirer de l’outillage méthodologique pour renforcer l’écriture investigative » par Wafaa Abou Chakra, professeure et responsable du centre de recherche à la Faculté des médias de l’Université libanaise. L’étude interroge jusqu’à quel point le journaliste d’investigation emprunte aux méthodes de la recherche scientifique pour construire son sujet et consolider les principes du journalisme d’investigation (https://studies.aljazeera.net/ar/article/6328).
Pourquoi distinguer journalisme d’investigation et journalisme traditionnel
Il est nécessaire de distinguer le travail journalistique classique de l’investigation. Le journalisme d’investigation ne se plie pas aux mêmes impératifs de rapidité ou à la recherche systématique du scoop. Il repose sur un investissement humain important et vise à produire des informations documentées dont la véracité prime sur l’urgence de publication.
Cette forme de journalisme se caractérise par :
- Une visée de documentation et de preuve plutôt que la seule transmission d’événements.
- Un travail qui se mesure souvent en mois ou années, non en jours.
- La recherche d’impacts concrets : changer une pratique, engager des responsabilités, protéger des victimes.
Avant de lancer un sujet d’investigation, le journaliste doit s’assurer de l’accès aux sources pertinentes et de sa capacité à obtenir des éléments probants qui démontrent le préjudice ou le problème à traiter.
Différences principales entre journalisme traditionnel et journalisme d’investigation
Les critères du journalisme d’investigation recoupent les standards généraux du métier, mais ils s’en distinguent par la complexité des exigences liées au choix du sujet et à la maîtrise de ses moindres détails.
La comparaison s’opère sur plusieurs plans :
-
Méthode de recherche et couverture :
Le journalisme traditionnel suit l’actualité et publie rapidement un minimum d’informations, souvent fondées sur des déclarations non documentées. Le journalisme d’investigation, lui, s’engage dans des dossiers complexes et de long terme, collecte et analyse de grands volumes de données, vérifie scrupuleusement et poursuit l’enquête jusqu’à l’établissement d’une histoire étayée par des preuves.
-
Relation avec les sources :
Le journaliste traditionnel s’appuie principalement sur des sources officielles et directes, parfois filtrées. L’investigation vise à découvrir des informations cachées, mobilise des sources diverses — formelles et informelles — et met l’accent sur la collecte et l’analyse d’éléments de preuve.
-
Nature du produit journalistique :
Le reportage classique restitue la réalité telle qu’elle apparaît, souvent sans jugement de valeur, et utilise des formats établis. L’enquête investigative cherche à percer le réel, relie victimes et responsables, attribue des responsabilités et propose parfois des pistes de correction. Son écriture se veut persuasive et structurée pour convaincre le public.

Convergences et divergences entre investigation et recherche scientifique
L’étude note que le journalisme d’investigation et la recherche scientifique se recoupent sur plusieurs plans méthodologiques malgré des finalités distinctes. Tous deux naissent souvent d’une motivation personnelle — curiosité, désir de révéler ou de comprendre — et traitent les problématiques comme des objets d’enquête soumis à collecte et analyse de preuves.
Points communs :
- Formulation claire de la question ou du problème à examiner.
- Construction d’hypothèses testées par des éléments probants.
- Vérification des sources et attention aux détails.
- Nécessité de définir précisément concepts et terminologie au fil de l’enquête.
Différences notables :
- Le terrain : l’investigation impose souvent des enquêtes de terrain et la recherche de témoins, tandis que la recherche académique peut se concentrer sur une documentation secondaire ou des archives.
- Transparence méthodologique : le chercheur privilégie la transparence des outils et méthodes; le journaliste peut protéger ses sources et ses procédés pour des raisons de sécurité ou d’efficacité.
- Finalité : l’investigation vise l’information du public et la responsabilité sociale, la recherche vise l’approfondissement des connaissances et la production théorique.
- Format et public : l’enquête privilégie une écriture synthétique et accessible; la recherche adopte un langage technique destiné au milieu académique.
Après des révolutions politiques récentes, notamment le printemps arabe (https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/2/24/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7), le journalisme d’investigation a adopté des outils méthodologiques plus proches de la recherche, surtout pour les enquêtes à risques ou celles fondées sur des données médicales, environnementales ou financières.
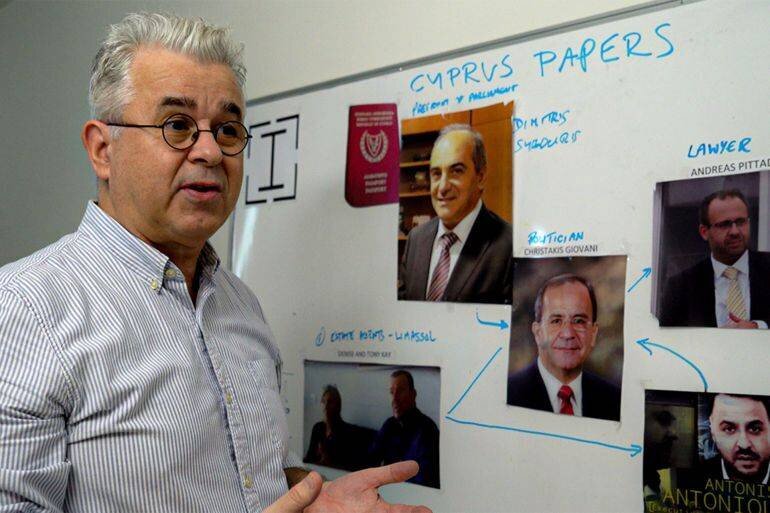
Outils et sources du journalisme d’investigation
Wafaa Abou Chakra rappelle que, face à une hypothèse, le journaliste d’investigation doit mener une réflexion méthodique : formuler des questions de recherche, identifier les sources et mobiliser les outils permettant d’y répondre.
Outils méthodologiques résumés :
- La documentation : recherche de documents, y compris ceux qui sont cachés ou confidentiels.
- La observation : suivi du comportement d’un échantillon à distance et consignation des observations.
- L’entretien : dialogues structurés ou semi-structurés avec des personnes clés pour recueillir des informations qualitatives.
- Le questionnaire : collecte de données quantitatives auprès d’un large échantillon.
- Les groupes de discussion : réunions contrôlées pour obtenir des réactions plus nuancées qu’en entretien individuel.
- Les tests : outils utilisés dans des enquêtes proches de l’investigation scientifique pour poser des questions standardisées.
Typologie des sources :
- Sources primaires : participants directs aux événements, documents officiels.
- Sources secondaires : témoignages, documents écrits ou audiovisuels.
- Sources expertes : personnes disposant d’une compétence technique ou d’un intérêt direct.
- Sources anonymes : informateurs protégés pour des raisons de sécurité.
- Sources ouvertes : données publiques, réseaux sociaux et études publiées.
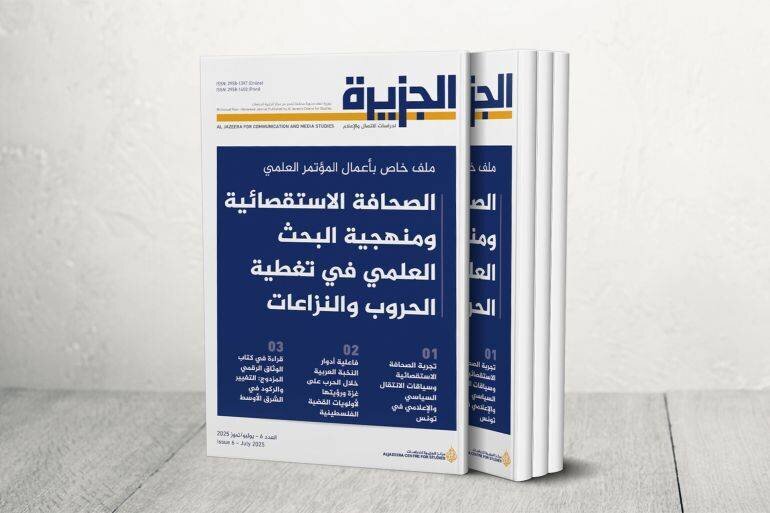
Enseignement et perspectives dans le monde arabe
L’étude conclut sur l’importance d’enseigner le journalisme d’investigation dans le monde arabe. Selon les auteurs, la discipline est aujourd’hui enseignée dans 79 universités arabes, en plus d’une offre de formations courtes et de stages destinés à doter les journalistes d’outils méthodologiques et éthiques solides.
La formation vise à :
- Donner aux journalistes des méthodes de collecte et de vérification rigoureuses.
- Renforcer la capacité à élaborer des plans d’enquête, à sélectionner des sources fiables et à choisir des méthodes d’analyse adaptées.
- Concilier impératifs éthiques, contraintes légales et exigences de qualité journalistique.
Malgré les défis pratiques et les sujets sensibles, le journalisme d’investigation dépasse la simple transmission d’informations : il révèle ce qui est dissimulé, s’appuie sur des démarches proches de la recherche scientifique et renforce la crédibilité et la qualité du travail médiatique dans la société.
Pour consulter l’étude complète : https://studies.aljazeera.net/ar/article/6328

